Dans un article précédent, j’ai essayé de montrer les raisons qui font que l’enjambeur est devenu un personnage central dans les organisations de par sa capacité à faire fi du réel, des connaissances minimales sur l’Homme et l’action collective, ce qui, dès lors, permet d’accréditer les pires sottises au grand dam des faits, de transformer l’insignifiance en nécessité absolue et la nécessité en gausserie.
L’instrument clé de l’enjambeur, c’est la phraséologie c’est-à-dire la langue de la « déconnance » (traduction de bullshit par Jacques Bouveresse) : la langue de l’indifférence à la vérité, indifférence pire que le mensonge comme l’avait montré Harry Frankfurt dans son ouvrage « On bullshit ».
Au-delà de la novlangue : la phraséologie
Faite de clichés, remplie d’images, la phraséologie a été finement théorisée par Karl Kraus, écrivain et satiriste autrichien. Ersatz de langue (Kraus distingue d’ailleurs la langue de la phraséologie), autoporteuse, clinique, paresseuse, la phraséologie ne laisse aucune chance à la capacité de penser donc à la complexité du réel. Elle supplante la novlangue managériale dans l’abstrait et l’abscons. En effet, tandis que la novlangue s’illustre par des euphémisations et des paraboles pour faire infuser un système de valeurs et des références afin de contrôler les consciences, la phraséologie managériale arrive en terrain conquis, les valeurs sont déjà intégrées et même professées, elle s’attelle donc à ne rien dire tout en disant quelque chose. Elle est faite, d’une succession de mots sans concepts établis sérieusement voire sans concepts du tout, qui finissent par ne poser de problèmes à personne : « embaucher des personnalités », « piloter la transformation des organisations », « mettre en œuvre le « travail hybride »… L’objectif de la phraséologie managériale est de consolider un double du réel déjà présent dans les esprits et dans les cœurs. Elle est l’instrument de la logistique du dernier kilomètre d’attention… à dérober.
La phraséologie est devenue, depuis de nombreuses années plus que la « langue » du management, elle est devenue le management (en tout cas sa branche mainstream) par le truchement de deux inducteurs : la simplification de l’Homme et du social et l’importation aveugle et partielle de concepts et de théories venant de diverses sciences.
- La simplification de l’Homme et du social
La simplification de l’Homme consiste à réduire l’humain et le social à leurs parts calculables et assujetissables à des indicateurs, à faire fi de toute singularité possible et à gommer les exceptions. Dans le pays idyllique d’un tel management, le réel, c’est le visible, le social, c’est un ensemble d’agents. Dès lors, ce qu’on ne peut pas comprendre par des chiffres ou à cause d’une non répétition, n’existe pas. Une telle absurdité, c’est ce que postule, en filigrane, le management mainstream qui ne prend au sérieux que les apparences au grand dam du sujet pensant et agissant, intégré dans un système de relations c’est à dire de pouvoirs. Cette réduction de l’Homme à sa dimension objectivable n’est pas illogique car elle est nécessaire pour le traiter en « ressource » humaine. Il s’agit, ni plus ni moins, d’une vaine tentative de programmation de l’Homme alors que la conduite rationnelle de ce dernier est difficilement programmable car elle est toujours un amalgame de différentes formes de rationalités (la rationalité instrumentale n’est qu’une des formes possibles de rationalités). Qui plus est, l’anomal n’est jamais une perturbation ou un bruit mais une ode à ce qui fait l’Homme : sa singularité
- L’importation aveugle et partielle de concepts et de théories venant de diverses sciences
Pour compenser les « pertes » du sujet simplifié et transformé en ressource (humaine), d’une part, on importe opportunément toute théorie et tout concept provenant d’autres sciences (anthropologie, psychologie, physique, mécanique…) sans en assumer la complétude, les conditions de possibilité, le sens circonscrit et d’autre part, on s’adonne à la généralisation hyperbolique de résultats fragmentaires. L’importation du concept de culture en entreprise en est une bonne illustration. La culture est un objet fondamental pour les anthropologues et les ethnologues (et bien d’autres spécialistes) qui mettent des dizaines d’années à comprendre partiellement une culture. Importée dans le management mainstream donc en entreprise, aucune précaution d’usage n’est alors nécessaire, on y parlera désormais de « plan de transformation de la culture de l’entreprise », de « pilotage de la culture de l’entreprise » comme si cette dernière était un objet de gestion facilement identifiable, modélisable à souhait et perméable à tous les traitements. Idem pour les mesures/indicateurs, les statisticiens savent les utiliser avec précaution car comme le stipule la loi de Goodhart que tout bon statisticien connaît, une mesure qui devient un objectif, cesse d’être une bonne mesure. En entreprise, les mesures deviennent vite des objectifs qu’il faut piloter, ce qui non seulement n’a aucun sens mais conditionne les esprits pour qui la carte devient le territoire avec toutes les manipulations et fraudes à la clé : il est beaucoup plus facile de manipuler la carte que le territoire.
Le management-phraséologie
Dans cette entreprise de construction de l’Homme actionnable par la simplification et l’importation de résultats partiels décontextualisés, la phraséologie devient le management c’est à dire le ciment nécessaire pour agir dans le sens souhaité tout en façonnant les esprits comme l’hypnotiseur qui avec ses tours nous détache de la réalité pour nous faire accepter ses ordres, nous transformant ainsi en comédien d’un spectacle dont on n’a pas lu le scénario. Comme Valery, je pense qu’il y a « quelque chose pire que l’absence de définitions et de noms exacts, c’est l’apparence de définitions et de noms exacts ». A la différence de l’hypnotiseur qui, à la fin de son tour, vous « réveille », la phraséologie agit comme un cancer de l’esprit car le retour en arrière est difficile pour l’esprit contaminé. Elle façonne un type d’homme prêt à enjamber le réel car comme nous l’apprend Emmanuel Mounier, à force d’ignorer, on oublie, à force d’oublier, on nie. La phraséologie, comme l’avait vu Kraus est un meurtrier de l’imagination. Elle est donc tout sauf neutre car elle transforme les Hommes en choses et les choses en Hommes en paralysant complètement l’imagination qui, dans un environnement de plus en plus complexe, demeure l’assurance vie suprême de toute organisation.
Un monde insensible au vrai et à la souffrance d’autrui
Ce qui tue l’imagination, tue l’avenir des organisations nonobstant les discours (marketing) actuels sur « l’intelligence collective ». Il n’y a pas d’intelligence collective, d’intelligence supra-individuelle devons-nous dire pour être rigoureux, dans les entreprises où règne en maître la phraséologie car comme le note François Daniellou, « les mots et les concepts qu’il est possible d’utiliser dans une entreprise, dans un milieu, à un moment donné, constituent aussi une injonction sur les formes de pensée ». On devient l’homme de son uniforme disait Napoléon, nous savons, au moins depuis Kraus, qu’on devient l’homme de sa phraséologie car cette dernière oriente à la fois les pensées et les sentiments. Klemperer l’explique brillamment dans son grand ouvrage sur la langue du 3ème Reich, la langue dit-il « régit tout mon être moral d’autant plus naturellement que je m’en remets inconsciemment à elle…Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelques temps l’effet toxique se fait sentir. Si quelqu’un, au lieu « d’héroïque et vertueux », dit pendant assez longtemps « fanatique », il finira par croire vraiment qu’un fanatique est un héros vertueux et que, sans fanatisme, on ne peut pas être un héros ». Parler et penser sont un, disait Kraus, ainsi, l’absence totale de respect pour le langage s’accompagne d’une absence de respect aussi complète pour l’être humain lui- même (Bouveresse).
Le monde du travail, fenêtre sur la société
Croyant comme d’autres en la centralité du travail c’est-à-dire au rôle éminemment important des entreprises et des organisations pour notre destin comme civilisation, je pense que lorsque le réel est enjambé grâce à la phraséologie, ce que Kraus avait redouté advient inexorablement : des hommes désensibilisés à la réalité (ou du moins ce qui ne les touche pas concrètement) par le récit, avec une insensibilité au vrai comme valeur (Engel et Mulligan).
Dès lors, nous construisons une humanité (composée d’enjambés et d’enjambeurs) qui comme le dit Kraus « ne sent rien jusqu’à ce que l’on touche à sa propre peau, ne perçoit dans la règle que l’exception, ne reconnaît son semblable que sous le concept de son personnage principal, ne réagit à la perte de son voisin que comme aux fluctuations de la chance et de la malchance, et se fait l’effet d’être déjà altruiste quand elle ne tire pas un profit usurier de la misère… ». Nous sommes tous témoins de cela dans les organisations. La duplicité, l’égoïsme, le fayotage, la morale de circonstance, la violence symbolique y sont souvent la norme. Qu’on ne s’étonne donc pas, comme l’avait vu Kraus, que le mélange entre « la toute-puissance du manque de caractère » produite ou induite par la phraséologie « en liaison avec une volonté crapuleuse », produit toujours des calamités. La phraséologie managériale qui arme la guerre économique (comme la guerre tout court, avec la presse, ce qui fut le grand combat de Kraus), transforme aussi l’encre en larmes si ce n’est pas en sang (comme dans toute guerre) avec l’augmentation des maux du travail qui peuvent aller jusqu’au suicide.
La nécessité d’un « nettoyage de la situation verbale » (Valéry) avant toute mise en œuvre d’un engagement
C’est donc une évidence de dire que toute réforme des entreprises et du management passera par une lutte acharnée contre la phraséologie si vous voulons avoir les armes adéquates pour faire face aux enjeux d’une entreprise intégrée dans un écosystème de plus en plus complexe, qui a beaucoup promis à la société (responsable sociale et environnementale notamment) et peu donné pour l’instant. En effet, il n’y a pas de responsabilité sociale et environnementale sans responsabilité devant le langage, la première des responsabilités car elle définit toutes les autres : on ne construit rien de concret et de soutenable sur la fausseté car la responsabilité nécessite toujours de penser sans fard le réel, penser c’est parler disait Kraus.
La lutte contre la phraséologie mérite autant d’engagement que la lutte contre les discriminations, à une différence près : la phraséologie est devenue, dans beaucoup d’entreprises, normale comme l’air qu’on respire car la doxa managériale est devenue une religion. Cependant nous savons avec Valéry que « la foi n’est pas compatible avec la description et la définition précise des choses auxquelles elle ne s’applique ni des formes réelles qu’elle peut prendre ». La tâche sera donc âpre.
Nous pourrons néanmoins nous adosser sur les épaules de Karl Kraus (et bien d’autres), peu connu d’une littérature managériale stérilement féconde mais qui inspira à Adorno, l’un des principaux représentants de l’Ecole de Francfort, cet hommage mémorable : « la non science, l’anti-science de Kraus surpasse la science ». Les chercheurs, consultants et praticiens en management qui veulent s’atteler à la diplomatie des disciplines que j’appelle de mes vœux pour sortir de l’enjambage du réel, gagneraient à étudier son œuvre qui est plus que d’actualité lorsque nous avons à démonter les ressorts de la phraséologie devenue le ciment d’une culture organisationnelle assise sur un « surprenant mélange de sensibilité aux détails et d’insouciance devant l’ensemble » comme l’avait si bien remarqué Musil. En attendant d’organiser la lutte contre cette « catastrophe de la mise en phrases » devenue la norme, « tout homme qui parle doit être arrêté. Il est en état de vagabondage linguistique » (Charbonneau)
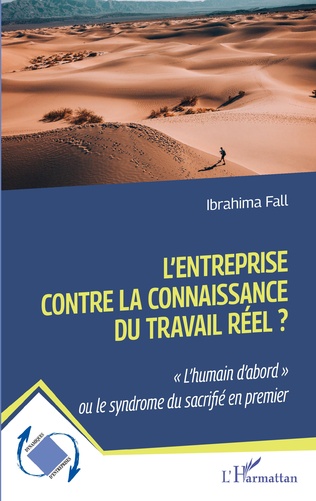




 …….
…….





