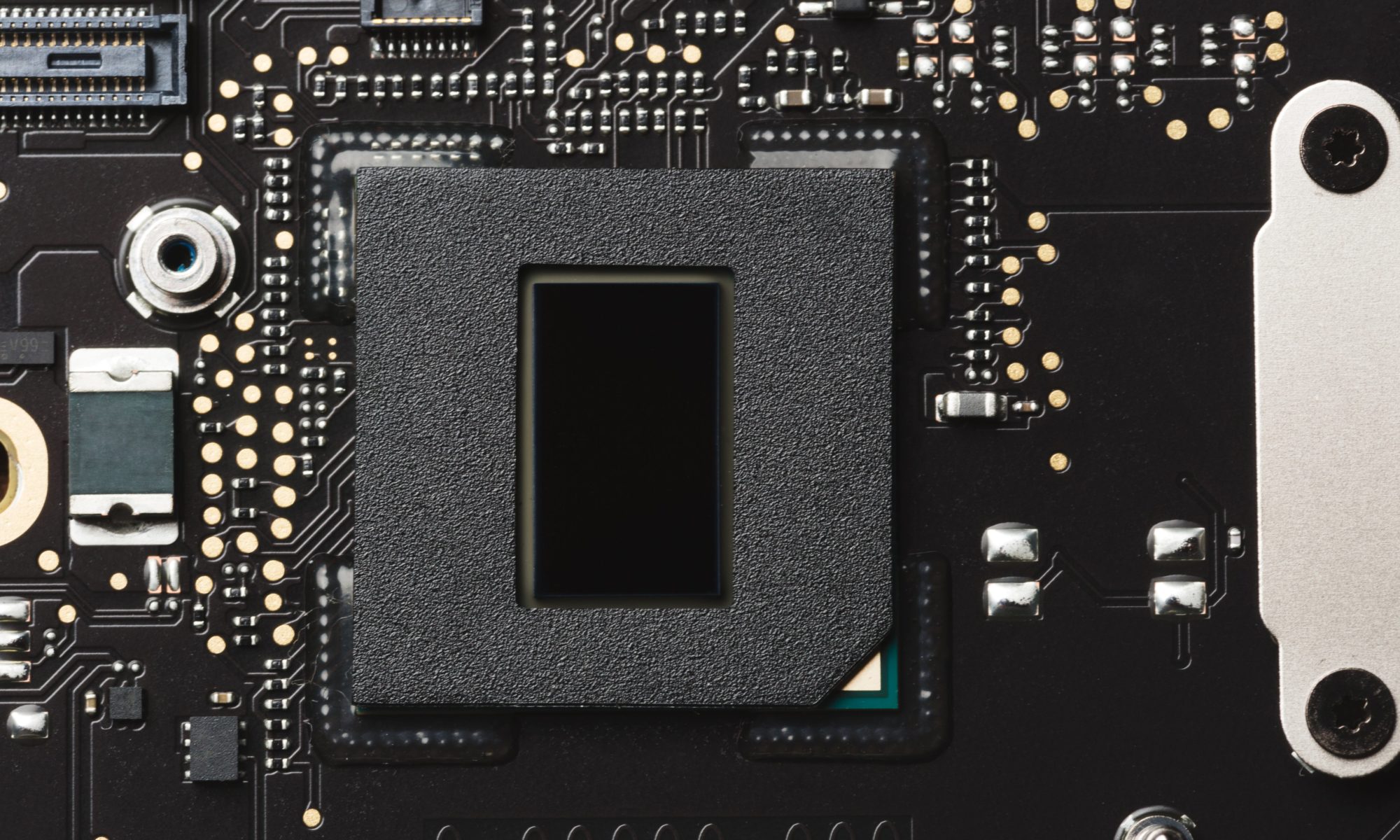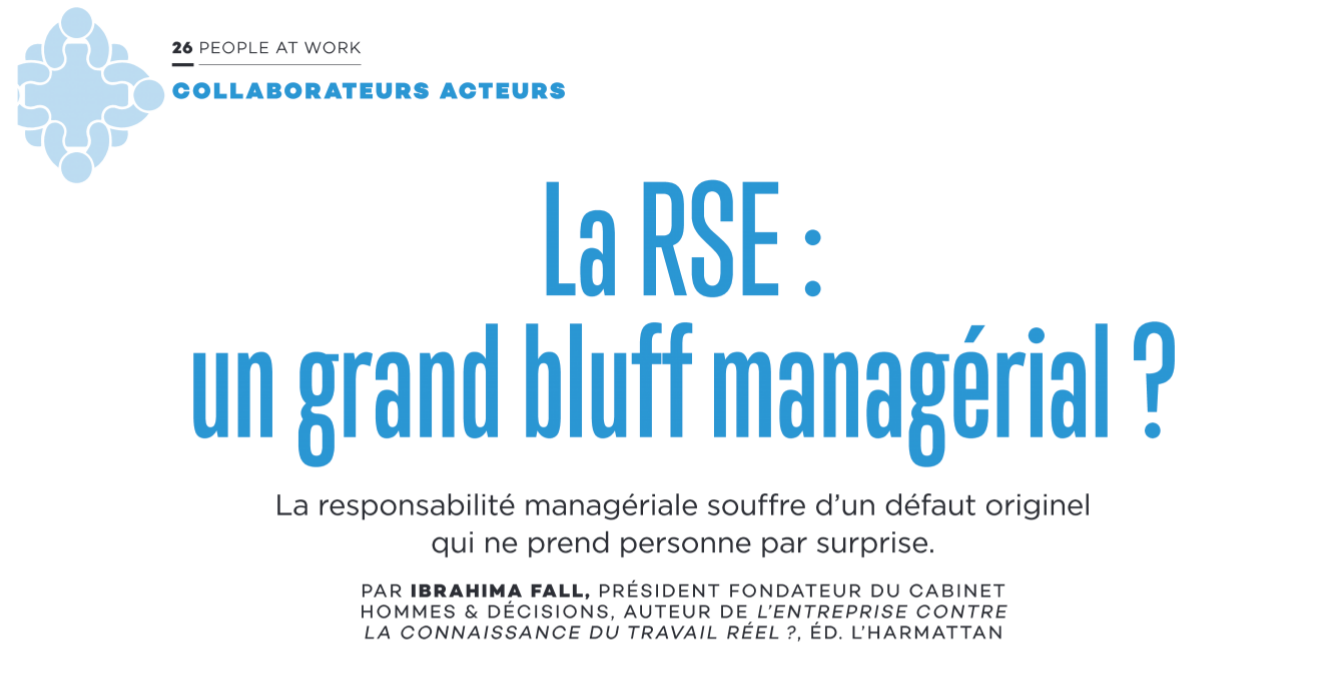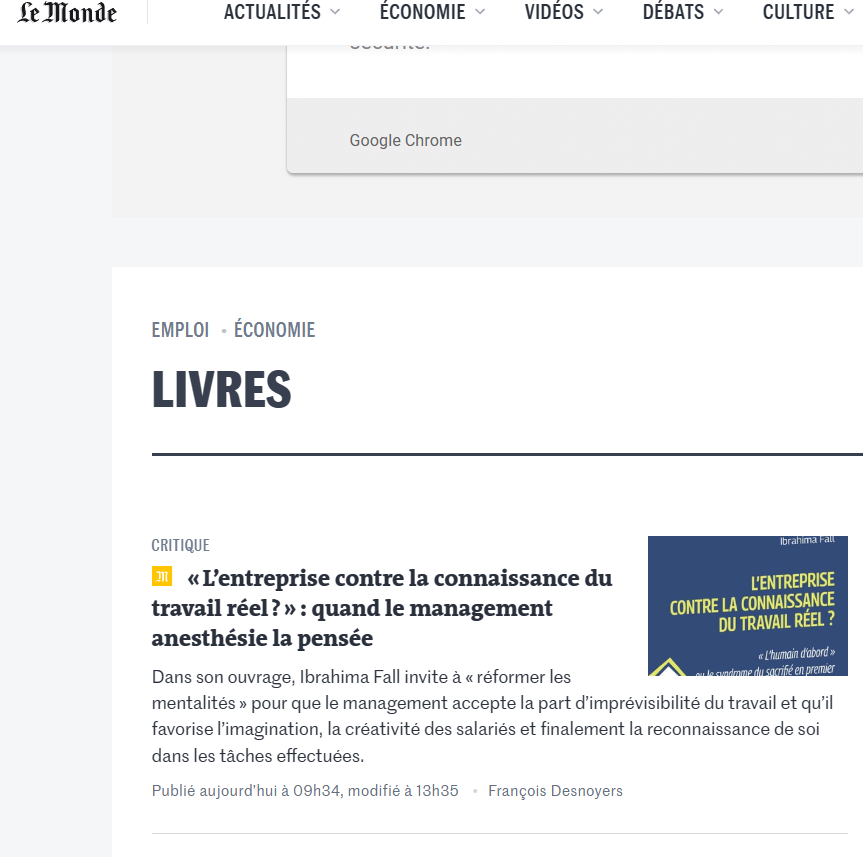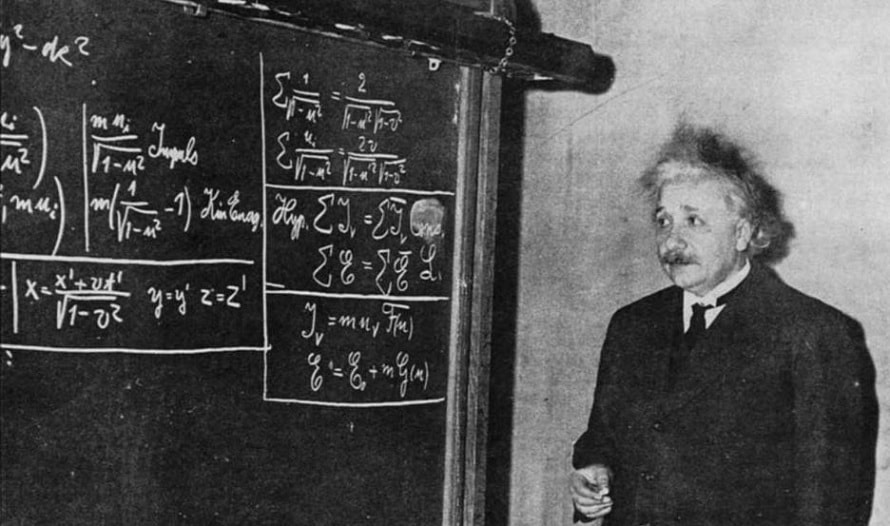Mais pourquoi donc est-il toujours aussi difficile de « bien » manager pour permettre aux femmes et aux hommes de mieux vivre ?
Au moins pour une raison : aucune école ou université ne forme un « bon manager » comme aucune école milaitre ne forme un « bon général ». Le jugement correct ne se prescrit pas. C’est l’objet de ma dernière vidéo sur Xerfi Canal
Pourquoi l’intelligence artificielle, paradoxalement nous oblige à investir massivement dans la culture ?
Les machines disait Gaston Berger sont « comme les habitudes, elles asservissent les faibles et affranchissent ceux qui ont des choses à dire ou à faire ». L’intelligence artificielle ne nous fait pas échapper à tel destin.
Ainsi, la bonne utilisation de l’intelligence artificielle comme toute technologie nécessite une élévation de la pensée à même d’engendrer une vision holistique, subtile et raisonnée des phénomènes et des situations pour ne point en faire un instrument supplémentaire de routinisation et donc de servitude. Pour ce faire, l’humanité n’a rien inventé de mieux que la culture par le truchement notamment de l’éducation classique.
Un grand chef d’entreprise français, Auguste Detoeuf, polytechnicien et fondateur l’Alstom, avait vu, il y a presque 70 ans, l’importance de cette éducation classique au service de l’industrie avec des arguments massues : « Certes, l’éducation scientifique doit être le fond même de la formation de l’industriel. Mais elle a besoin d’un correctif, d’un principe équilibrant, que seule peut donner l’éducation classique; sa sécheresse, son formalisme étroit exercent trop naturellement sur l’esprit un despotisme véritablement tyrannique. C’est à un positivisme mesquin, ou à une conception étrangement théorique de l’Univers et de la Vie que conduit nécessairement un scientifisme sans barrières. Cette manière commode mais au fond trompeuse et décevante, de considérer, disséquer et de reconstruire les choses, exerce, grâce à la paresse naturelle de l’homme, un irrésistible attrait. Vus du point de vue où elle nous place, les mots ne sont plus que des signes trop précis, trop définitifs et, à dire vrai, sans interprétation pratique. La méthode scientifique annule toutes les nuances et crée partout des différences tranchées; la souplesse infinie de la vie lui échappe et, pour celui qui ne connaît qu’elle et qui est dominé par elle, au lieu de se subordonner à cette souplesse, de tâcher de s’y adapter tant bien que mal, elle la veut réduire et figer en formules. Rien n’est plus faux, pratiquement, ni plus dangereux. (Pages retrouvées, page 56)
C’est cette conception étriquée, binaire, absolument efficace et non dénuée de jugements de valeur (Jean-Pierre Séris) dont héritent, de facto, les outils technologiques. Rien n’est donc « plus dangereux » pour reprendre les mots de Detoeuf qu’une intelligence artificielle qui ne rencontrerait pas « les correctifs » adéquats c’est à dire les infrastructures intellectuelles, morales, culturelles, sociales et politiques par le truchement de la nuance, du recul, du doute, de l’imagination, de la sensibilité, du tact, grosso modo tout ce qui permet de l’orienter au service de l’Homme. Seuls ces correctifs, ce supplément de conscience et de forces morales comme dirait Georges Friedmann permettent au Pharmakon de pencher plus du coté du remède que du poison. Ces correctifs ne vivent donc pas dans les choses mais dans les Hommes. L’intelligence artificielle qui implique des transformations profondes de nos organisations n’est donc pas un problème technique à résoudre mais un projet de société à penser et à mettre en œuvre. L’utiliser à bon escient est donc un pari sur l’intelligence humaine car utilisée intelligemment, l’intelligence artificielle ne s’oppose pas à l’intelligence humaine, elle la suppose.
Nous avons donc une opportunité historique pour faire enfin dialoguer grandeur et valeur, moyens et fins, scientifiques et poètes, par le truchement d’un investissement certain dans la culture au profit d’un Homme complet. Cet Homme, résolument responsable et tourné vers le futur dont Gaston Berger avait d’ailleurs dessiné les aptitudes majeures : « voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques, penser à l’homme » car disait t-il « tout commence par la poésie mais rien ne se fait sans la technique. Mais il faut que la poésie soit partout si présente que l’apprentissage des mécanismes ne tarisse pas la source vive de la création ».
Science, compétence, art : pourquoi résumer le management à une de ces notions traduit toujours une erreur de catégorie ?
Une philosophe connue qui écrit sur l’entreprise a récemment déclaré que le management n’était pas une promotion mais une compétence. C’est d’ailleurs un avis communément admis.
Même si je comprends l’idée sous-jacente dans une telle affirmation notamment le fait que tout le monde n’est pas fait pour être manager et que le management ne s’improvise pas (je suis de cet avis), il est curieux de dire que le management n’est pas une promotion tout en la résumant à une compétence. En effet, du moment où les compétences sont censées s’acquérir par le truchement de plans de développement de compétences sur la base de « référentiels de compétences », le management peut de facto être une promotion ! La phrase en question ne satisfait donc pas le fameux principe logique de non contradiction (Aristote). Opposer dans la même phrase promotion et compétence est une auto réfutation par l’auteur de sa propre thèse.
Si manager, c’est travailler le divers (dans le sens premier du terme) c’est à dire obtenir le plus en sacrifiant le moins à partir de réalités diverses allant dans des directions opposées (temps court vs temps long, efficacité immédiate vs efficacité de long terme, confiance vs procédures, commensurabilité vs singularité, préservation de l’environnement vs rentabilité économique, utilisation efficace de la force vs respect de dignité etc…), il me semble que la racine du problème réside justement dans la croyance que le management serait une compétence et qu’on pourrait dès lors l’acquérir de manière instrumentalisée via un plan de développement de compétence ou plus ou moins facilement sur le tas, l’expérience aidant.
Je saisis donc cette occasion pour, humblement, essayer de faire quelques clarifications car nous devons prendre au sérieux cette mise en garde de Horkheimer et Adorno, il y a plus de 70 ans : « lorsque la vie publique a atteint un stade où la pensée se transforme en marchandise, la tentative de mettre à nu une telle dépravation doit refuser d’obéir aux exigences linguistiques et théoriques actuelles avant que leurs conséquences historiques rendent une telle tentative totalement impossible ».
Ainsi, le management n’est pas une compétence si par compétence nous entendons l’aptitude à satisfaire une tâche c’est à dire l’exécution d’un ensemble d’instructions pour satisfaire une classe de problèmes, ce qui n’est rien d’autre que l’expression d’une capacité d’adaptation, le nec plus ultra de la pensée algorithmique (le travail de machine). Le management par essence déborde la tâche car il doit au moins pouvoir la « critiquer » dans le sens premier du terme (avoir du discernement à son encontre) donc il ne peut pas se résumer à l’expression d’une compétence. Ce qui déborde la tâche, c’est l’imagination et la sensibilité, ingrédients essentiels pour produire des jugements corrects (Sentir, c’est produire nous dit justement Paul Valéry). La capacité à faire des jugements corrects ne s’acquiert pas sur le tas et il n’y a aucun lien de causalité entre une telle capacité et la détention d’une compétence technique.
Le management n’est pas une science si par science nous entendons « l’ensemble des recettes qui réussissent toujours » (Paul Valéry). Aucune recette managériale ne réussit partout et tout le temps malgré la réclame sur les « bonnes pratiques » dans les livres de management. Les managers ne sont donc pas des « scientifiques » du travail, c’est un truisme de le dire. Néanmoins, le management peut et doit se fonder autant que possible sur la science.
Le management n’est pas un art si par art nous entendons comme le dit Jacques Thuillier, historien de l’art et collectionneur « la création d’une forme qui se signifie elle même ». Le management ne se signifie pas lui même, au contraire, il est toujours en relation dialogique avec un environnement en perpétuel reconfiguration dans lequel il s’encastre pour faire sens. Si le management devait être un art, il serait un art de faire vivre les Hommes et les choses dans le temps et dans l’espace. Ce qui ne nous renseignerait en rien sur son contenu.
Le management n’est donc ni une science ni une compétence ni un art dans l’acception moderne du mot. Alors qu’est-ce que le management ?
Le management est une création de l’esprit qui se concrétise dans le réel du travail. C’est donc une pratique mais pas n’importe laquelle : c’est une pratique réflexive et politique (l’exigence de ne pas perdre le sens des ensembles) qui peut nécessiter des compétences, de la science, le doigté de l’artiste mais aussi et surtout de l’imagination et de la sensibilité pour penser le pire afin de l’écarter et pour cultiver le meilleur dans le temps et dans l’espace. Le manager est, dans cette optique, un artisan d’un réel toujours ancré dans le futur : un artisan du jugement correct.
C’est pourquoi, le management réduit à une compétence, ne peut être que l’apanage de préposés au management. Bien sûr, il nous faudrait plus de managers et moins de préposés au management ; mais pour se faire, il faut remettre dans jeu, le « je » qui a été mis hors jeu par la force des choses ou peut-être simplement par opportunisme : il faut plus sérieusement s’intéresser à l’Homme à qui l’on donnera la lourde tâche de manager car l’intelligence ne dépend pas de ce que nous savons mais de ce que nous sommes (Hubert Dreyfus).
La formation d’un tel Homme n’est pas chose aisée car elle ne peut pas être instrumentale c’est à dire avec des plans d’apprentissage réglés et contrôlés. En effet, comme nous l’apprend Wittgenstein dans « Recherches philosophiques », lorsqu’il s’agit de jugement, « ce qu’on apprend n’est pas une technique ; on apprend des jugements corrects. Il y a également des règles, mais elles ne forment pas un système, et seuls les gens expérimentés peuvent les appliquer correctement. A la différence des règles de calcul. Ce qui est le plus difficile ici est d’exprimer l’indétermination correctement et sans la falsifier ». Ce qui est donc en jeu, c’est moins « la formation des managers » comme nous le disons communément que la formation des citoyens dont certains d’entre eux deviendront des managers. Les universités et les écoles forment-elles toujours, d’abord des citoyens ? Nous avons plutôt l’impression que « l’employabilité » a phagocyté l’éducation et la civilité c’est à dire la formation de l’être humain et du citoyen! Ce qu’un penseur comme Bernanos avait bien vu : « dans l’ordre de la technique, un imbécile peut parvenir au plus haut grade sans cesser d’être un imbécile ».
Ainsi, il nous faut travailler sur ce que j’appelle une poétique des conditions de l’altérité, poétique dans le sens valéryen du terme (création), c’est à dire un travail sur les conditions de possibilité d’un Homme capable de se penser et de penser sa relation à tout ce qui peut lui être extérieur (les autres êtres humains, l’environnement dans lequel il vit, les objets qu’il crée et manipule). Un tel projet dépasse de loin les seuls enjeux managériaux car il s’agit d’une véritable politique de civilisation (Edgar Morin) face à l’indétermination de la vie et ses conséquences multidimensionnelles qui ne prennent personne par surprise. Kraus avait raison: « les bonnes idées sont sans valeur, ce qui compte, c’est celui qui les a ». Nous avons trop longtemps minimisé le travail indispensable sur celui qui accueille les idées et qui de fait les transforme. Aucune théorie managériale ne peut être féconde si elle ne rencontre pas un être humain dont les idéaux dépassent les instincts.
Là où règne une demande d’efficacité totale et immédiate, c’est à dire l’impératif de minimiser les coûts et de maximiser les gains hic et nunc , nul besoin de « manager », le préposé au management fera l’affaire !
L’interdiction de fait de l’imagination théorique notamment par le culte de la technique et de l’efficacité immédiate ouvrira toujours la voie à la folie politique (Horkheimer et Adorno) donc, bien sûr, à la folie managériale. Ainsi, aussi longtemps que l’école mettra à profit uniquement les disciplines qu’on peut traduire en langage de machine c’est à dire les disciplines « techniques », que l’apprentissage sera basé sur l’approche exclusive par les compétences, que la concurrence entre les élèves sera la norme, que faire du « bon business » se résumera à être efficace hic et nunc sans penser le prix humain, social et écologique à payer, le manager sera une exception et le préposé au management la règle, cet Homme disait sir Richard Levingstone qui comprend tout dans son travail, « excepté son but ultime et sa place dans l’organisation universelle ».
Prendre le changement pour la transformation : une méprise qui peut être fatale pour toute organisation !
Oui, même dans le management et la gestion des entreprises, Jules Renard a raison : « il n’y a pas de synonymes. Il n’y a que des mots nécessaires».
Ne pas faire le distinguo entre changement et transformation dans un contexte fortement marqué par des défis à relever (technologiques, sociaux, sociétaux, environnementaux…), c’est investir inexorablement dans l’échec !
C’est l’objet de ma dernière vidéo sur Xerfi Canal
La RSE : un grand bluff managérial ? ARTICLE publié le magazine People at Work
Critique de mon livre « L’entreprise contre la connaissance du travail réel ? L’humain d’abord ou le syndrome du sacrifié en premier » dans le journal Le Monde : « quand le management anesthésie la pensée » Par François Desnoyers
La formule « L’humain d’abord » déclinée à l’envie et dans toutes les nuances, est aujourd’hui sur toutes les lèvres. Désormais, il n’y a plus que les criminels qui osent « œuvrer » sans se placer sous l’égide de « l’humain ». Comme Wolé Soyinka (prix Nobel de littérature 1986), je pense que « le tigre ne crie pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore ». L’humain ne se proclame pas, les bonnes actions n’ont pas besoin de porte-voix. C’est un truisme de le dire! « l’humain d’abord », c’est donc souvent un leurre! C’est l’objet de ma dernière vidéo sur Xerfi Canal
Les sempiternels faux problèmes du management
Une entreprise comme toute organisation a besoin de foi. Cette foi s’exprime par le biais de croyances ancrées comme la nécessité de situer son action au-delà des besoins matériels de l’être humain et ainsi œuvrer pour des idées qui dépassent la satisfaction d’intérêts personnels. Ce que l’on sait moins, c’est la place qu’occupent les faux problèmes dans ces mêmes organisations, faux problèmes qui sont autant d’actes de foi. Paraphrasant Jacques Ellul au sujet de la politique, on peut dire que le management institutionnalisé est devenu l’art de généraliser de faux problèmes, de donner des faux objectifs et d’engager de faux débats, le tout avec une mobilisation bien réelle des femmes et des hommes.
Ainsi, s’il y a quelque chose bien réelle dans les organisations et leur management, ce sont les faux problèmes qui engendrent un déploiement non négligeable de ressources pour ne produire que des fausses solutions. Néanmoins, les fausses solutions ne sont pas que des ersatz de réponses à de faux problèmes car bien souvent, elles finissent par engendrer de vrais problèmes managériaux. En outre, les faux problèmes mobilisent beaucoup d’énergie, de temps et donc d’argent pour des résultats plus que discutables tout en embolisant la capacité à faire. Pendant qu’on s’occupe des faux problèmes, on ne s’occupe pas des vrais problèmes.
En voici quelques-uns :
Le besoin de référentiels de compétences : Personne n’a jamais vu directement une compétence de sa vie car elle n’existe que dans l’action (elle ne s’observe pas directement mais se déduit) , néanmoins cela n’empêche pas les entreprises et les institutions publiques de se mobiliser grandement pour formaliser des « référentiels de compétences ». Cherchez l’erreur ! Nous sommes donc souvent en présence de parfaites usines à gaz de « choses » qui ne sont pas censées se voir à l’œil nu, vous partagerez avec moi mon incrédulité face à ce type de réalisations ; Malgré cela, ces référentiels sont devenus centraux dans beaucoup d’organisations car ils déclenchent, entre autres, des parcours de formation et des appréciations sur les « compétences » supposées des individus. D’ailleurs, chaque entreprise choisit une architecture et un niveau de granularité différents pour décrire les « compétences » nécessaires à son développement. On pourrait même dire qu’il y a autant de modèles de compétences que d’entreprises. Qui a raison ? personne ne le sait !
J’ai donc toujours été amusé par cette grande mobilisation de femmes et d’hommes pour le travail fastidieux dit de formalisation de référentiels de compétences. Les entreprises peinent d’ailleurs souvent à les mettre à jour car le réel résiste et que la complexité est difficilement modélisable dans un onglet Excel. Disons le clairement, la compétence est un construit social. Comme le précisent les auteurs de l’ouvrage collectif « Traité de psychologie du travail et des organisations » sous la direction de Jean-Luc Bernaud et Claude Lemoine, « la sociologie du travail a bien mis en évidence que la compétence est un construit social répondant à d’autres logiques que celle strictement limitée à l’identification et l’évaluation des conditions individuelles de la performance au travail ». La compétence déborde donc toujours l’individu. En outre, étant donné qu’il y a toujours un décalage entre le travail prescrit et le travail réel car le travail est par définition vivant, aucun référentiel de compétences (soft ou hard skills) ne peut présupposer l’intelligence pratique nécessaire pour réaliser une tâche car comme l’ont montré les ergonomes, cette intelligence pratique est même en avance sur la conscience que les travailleurs en ont et sur la verbalisation qu’ils peuvent en faire. Bien sûr, il faut former les travailleurs aux techniques en cours ou à venir mais réfléchir sur le caractère capacitant de l’environnement de travail mobilisera autant voire moins de ressources pour des gains plus assurés.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue le fait que beaucoup de grandes réalisations des entreprises ont pu voir le jour sans cette armada de référentiels de compétences. La notion de compétence n’émerge qu’à partir des années 70 sous l’impulsion d’un certain David McClelland, enseignant de psychologie (à l’Université Harvard et spécialisé dans l’étude de la motivation) et fondateur du cabinet de conseil Hay-McBer (devenu Hay Group) et grâce au travail intéressé « d’évangélisation » des cabinets internationaux de conseil. La compétence professionnelle apparaît réellement en France selon un rapport de France Stratégie paru en avril 2021 qu’à «l’orée des années 1990, sous la forme d’un « modèle de la compétence »». Il y avait donc une vie dans les entreprises avant les référentiels de compétences, c’est un truisme de le dire.
La nécessité d’une conduite du changement : « conduire le changement » est une expression passée dans le jargon managérial même si lexicalement, elle ne veut pas dire grand-chose. Le changement est souvent abusivement assimilé à la transformation. Ainsi conduire le changement, c’est en filigrane, inciter le corps social à se transformer à coup d’informations, de formations voire de coaching. Il y aurait ainsi deux camps : le camp des « sachants », le camp de ceux qui ont compris et qui réfléchissent pour les autres et le camp des nigauds qu’il faut inciter à changer car c’est dans leur intérêt. Une telle perception de la réalité traduit une méconnaissance d’une part des dynamiques organisationnelles et d’autre part des conditions de possibilité d’une transformation. Il est utile de rappeler que pour transformer, il faut comprendre le réel du travail et les dynamiques qui s’y jouent. Ce n’est qu’à partir d’une telle connaissance, qu’on peut mettre en œuvre les conditions (au bon niveau de maturité) d’une véritable transformation. Les démarches instrumentales de conduite du changement rassurent même si très couteuses mais elles sont surtout les véhicules d’un certain transformisme qui, par essence, passe à coté des sujets de fond. Néanmoins, les faits sont têtus : tout transformisme est voué, un jour, à atteindre un seuil de retournement, atteinte qui se manifeste souvent par le truchement d’une crise qu’on aurait pu éviter par le simple fait de respecter le réel. Les nombreuses ressources internes et externes et les budgets conséquents mobilisés pour répondre à ce faux problème sont autant de ressources qui auraient été nécessaires pour mettre en œuvre les conditions d’une véritable transformation au-delà des mots. D’ailleurs, il est à noter que selon les études, une majorité des projets de transformation digitale sont en échec c’est-à-dire que les résultats opérationnels escomptés ne sont pas atteints. Pas besoin d’être un grand logicien pour se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond au royaume de la conduite du changement.
L’indispensable partage des valeurs par le storytelling : La narration organisationnelle (storytelling) nous dit Thierry Burger-Helmchen, chercheur en sciences de gestion « est le processus continu de construction de sens (sensemaking), d’une culture historique commune, et de connaissances partagées entre les membres d’une organisation afin de comprendre le passé, partager les événements du présent et fabriquer l’avenir. Il s’agit de manager l’histoire de l’entreprise et, de préférence, grâce au storytelling, de présenter sous un jour favorable les actions passées des managers, la naissance des produits phares de l’entreprise, sa croissance et sa conquête de certains marchés, ainsi que ses principaux succès. Ainsi, la narration organisationnelle définit les récits à travers lesquels certains événements, parfois majeurs, parfois insignifiants, se chargent d’une signification symbolique et participent à façonner la culture interne et la renommée externe de l’entreprise ». En matière de travail, les contes de fées n’existent pas. Les valeurs ne se proclament pas, elles doivent être incarnées dans le réel du travail. C’est pourquoi pour le sociologue Albert Ogien, reprenant les travaux de Dewey, « « ce qui fait valeur » se dévoile à mesure que les individus découvrent ensemble « ce à quoi ils tiennent » dans une situation d’action précise ». Dès lors, « les valeurs peuvent prendre un contenu très différent selon le contexte de l’activité dans laquelle l’usage qui en est fait se réalise ». Discourir sur les valeurs en pensant transmettre par ce biais du sens ou des valeurs est une vue de l’esprit. D’ailleurs, plus les valeurs proclamées sont éloignées des valeurs « logées dans les activités » (selon l’expression consacrée), plus vous risquez de créer du cynisme voire pire du désengagement. Cette énergie déployée dans la construction de discours mériterait d’être mise au service de la connaissance du travail réel et de la mise en œuvre effective de véritables collectifs de travail au-delà du travail collectif.
Ces trois exemples ne sont que quelques-uns des faux problèmes qui embolisent la capacité à faire des organisations. Ils dérivent tous d’une propension à l’abstraction et au formalisme qui a pour conséquence d’enjamber l’existence et le concret. Ces faux problèmes ont néanmoins toujours un sens symbolique non négligeable : la conduite du changement traduit la confirmation de la stratification structurelle (ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent), une légitimation des grades et des rapports de pouvoirs liés ; les référentiels de compétences renvoient au vieux mythe du travail exact et à la peur ontologique de l’incertitude ; la transmission des valeurs par le storytelling met en exergue une conception moderne du paternalisme managérial et de la croyance en un sens qui serait dans les mots.
Il n’y a donc pas de tabou à s’attaquer à ces faux problèmes, bien au contraire. Cela ne sera pas juste faire œuvre de salubrité organisationnelle mais il s’agira aussi de dégager de la capacité à faire pour enfin s’atteler aux sujets fondamentaux. En effet, les vrais problèmes ne manquent pas : bâtir les conditions d’une transformation de plus en plus perlée (successions rapides de transformations), organiser la compétition argumentative pour ajuster les perspectives, mettre en œuvre des environnements capacitants, réfléchir sur la morale du travail… Pour l’ensemble de ces sujets, il n’y aura pas de « solutions », seulement des « arrangements » car nous ne sommes pas dans le registre des problèmes mathématiques ou techniques mais dans celui des problèmes « managériaux » qui sont éminemment « politiques » c’est-à-dire nécessitant de ne pas perdre le sens du tout. Avec tous les défis (technologiques, environnementaux, sociaux…) que les entreprises doivent relever, Il est plus que jamais nécessaire de traquer les faux problèmes pour se mettre enfin à travailler sur le réel des problèmes.