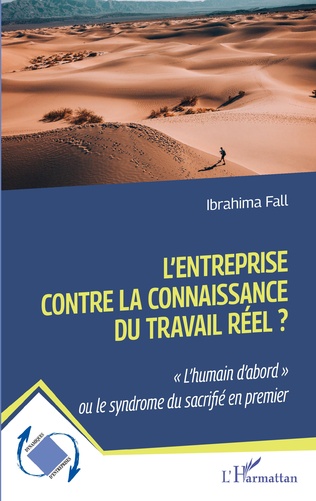De nos jours, vous verrez rarement une offre d’emploi sans son lot de demandes concernant les soft skills (compétences douces). Passez en revue quelques offres et vous pourrez en faire une liste à la Prévert : être autonome, savoir s’adapter, savoir résoudre des complexes, avoir de l’esprit critique, être créatif, être orienté équipe, avoir de l’intelligence de situation, le sens du service, la flexibilité, l’empathie, savoir gérer le temps, savoir gérer le stress, avoir de l’audace, avoir le sens du collectif… Lesdites soft skills désignent donc des choses tout à fait différentes de nature (des traits de caractère, des traits de personnalité, la capacité de jugement intellectuel, l’intelligence sociale…); il n’est donc pas étonnant qu’il n’existe ni définition stabilisée de la notion ni théorie générale unifiée. Malgré ces limites fondamentales, nous avons néanmoins la sensation que les collaborateurs sont devenus les nouveaux Victor de l’Aveyron et que des docteurs Itard se penchaient sur leur sort. Désormais, le cv semble être has been, des entreprises proposent, clé en main, de fournir des « solutions » permettant de « recruter les meilleures personnalités », d’autres promettent « d’identifier les contextes dans lesquels une personne est efficace ou non dans l’exercice de sa fonction ». On pourrait multiplier les exemples « d’innovations ». Le concours Lépine des soft skills est bel et bien lancé. D’ailleurs, Pole Emploi, dans un article daté de mars 2022 prédit que d’ici à 2030, « les soft skills seront au cœur des stratégies de recrutement des entreprises ».
Les demandes de soft skills : une temporalité qui est tout sauf neutre
Les demandes de soft skills (et l’offre qui va avec) s’inscrivent dans une temporalité particulière. Elles émergent en même temps que l’accroissement de la demande et de l’offre de coaching, laquelle coïncide avec l’atteinte par beaucoup d’entreprises et d’organisations du fameux seuil de retournement, seuil à partir duquel un point de performance en plus produit dans l’organisation, plus de méfaits que de bienfaits, tout progrès de l’organisation s’entourant d’une auréole de désorganisations qui appelle une nouvelle salve de réorganisations et de nouvelles désorganisations et ainsi de suite. Avec les soft skills comme barrières à l’entrée (de l’entreprise ou d’une fonction) et le coaching comme investissement in situ, l’humain devient ainsi le régulateur rêvé d’un système organisationnel détraqué dans lequel le travail prescrit prévaut sur le travail réel avec les conséquences qui en découlent : coopération de survie c’est à dire une coopération réduite au strict minimum et intermédiée principalement par les outils techniques au détriment de la parole, difficultés de faire coexister les égoïsmes, défiance généralisée, sentiment d’être dépossédé de son travail…
La demande de soft skills s’inscrit ainsi totalement dans la philosophie gestionnaire de l’époque : traiter les symptômes en lieu et place des causes, s’intéresser plus à la qualité intrinsèque des individus qu’à la qualité du travail, présupposer que l’abstraction et le formalisme permettent ipso facto l’efficacité.
Les soft skills ne sont donc qu’un puissant leurre et un vrai pansement sur une jambe de bois, pour plusieurs raisons :
- D’abord, c’est une chose d’avoir le souhait de recruter des individus ayant les soft skills x,y,z, encore faut-il être capable d’évaluer ces soft skills. Il s’est donc développé un business de l’évaluation des soft skills par des techniques et des méthodes diverses (auto évaluation, tests psychométriques…) car bien sûr, il y a une demande donc il faut la combler. Le modus operandi consiste à formaliser des critères d’évaluation définis en dehors des conditions d’exécution desdites soft skills. Le raisonnement peut sembler logique mais demeure profondément erroné. Une compétence (ou une habileté) ne s’exprime que dans l’action. C’est comme juger le courage d’un Homme à son discours sur le courage, on risque d’être déçu. De plus, la performance dans la réalisation d’une tâche dépend entre autres, de l’intérêt que vous y trouvez ou pas (facteurs psychologiques) mais aussi de facteurs physiologiques qui sont des réponses de l’organisme à la situation de travail (expression des émotions par exemple). Il est donc difficile pour un test d’évaluation de soft skills réalisé en dehors du contexte effectif de donner des résultats probants. En outre, ce n’est pas parce qu’une compétence s’exprime dans l’action qu’elle est verbalisable donc modélisable. Le travail reste un mystère car à la croisée de 3 mondes : le monde objectif, le monde psychique et le monde social. Paradoxalement, il est vu de manière assez simpliste par beaucoup de théoriciens et de praticiens du management. Les tests d’évaluation des soft skills en sont la preuve. Ces tests sont souvent au travail ce que l’orviétan était à la médecine : un faux remède.
- Si nous faisons l’hypothèse qu’un acteur Y a les « soft skills » nécessaires pour réaliser une tâche, il serait héroï-comique de penser qu’à lui seul, il puisse entraîner l’organisation (ceux qui concourent à la réalisation de la tâche) uniquement par le truchement de ses soft skills. Ce raisonnement ne résiste que difficilement à la réalité car le travail étant par définition collectif, les dynamiques à l’œuvre sont multidimensionnelles.
Supposons que tous ceux qui concourent à la réalisation de la tâche aient les « soft skills » idéales, ils se heurteraient au fait que le réel, n’est pas d’abord possible (Henri Maldiney). En effet, le réel, comme le dit Christophe Dejours, « c’est ce qui se fait connaître au sujet par sa résistance aux procédures, aux savoir-faire, à la technique, à la connaissance. C’est-à -dire par la mise en échec de la maîtrise ». Autrement dit, il y a toujours un décalage entre le travail prescrit et le travail réel car le travail est par définition vivant. Ainsi aucun référentiel de compétences (soft ou hard skills) ne peut présupposer l’intelligence pratique nécessaire pour réaliser une tâche car comme l’ont montré les ergonomes, cette intelligence pratique est même en avance sur la conscience que les travailleurs en ont et sur la verbalisation qu’ils peuvent en faire.
Dès lors, la prescription de soft skills apparaît comme naïve eu égard à la complexité de l’activité. Du moment où ce qui fait que « ça marche » échappe au moins en partie, à une « conceptualisation explicite » des acteurs concernés, il est illusoire de s’en référer à un référentiel de soft skills et/ou de hard skills. L’activité est énigmatique et elle le restera quoi qu’en pense les gestionnaires férus de modélisations et de prescriptions car réussir n’est pas comprendre (Piaget). Ce n’est pas parce qu’on a réussi à réaliser une tâche qu’on a nécessairement compris la manière dont nous y sommes parvenus.
La demande de soft skills est donc l’arbre qui cache la forêt de l’impensé du travail dans les organisations. Les référentiels de soft skills ne sont bien souvent que des horoscopes managériaux et comme tout horoscope, ils répondent au besoin de prédire et de savoir, qu’importe si la fausseté et l’illusion l’emportent sur la réalité et la vérité.
- Que vaut un soft skill sans le hard skill et le contexte qui vont avec ? Exemple : pour ouvrir une porte, il faut une porte, une théorie de ce qu’est une porte et la capacité physique de faire le geste. Imaginons, un portier à l’entrée d’un bâtiment officiel, Il sera difficile pour ce dernier de sourire et de répondre lucidement aux questions que lui posent ceux qui empruntent la porte s’il sait par avance que cette dernière se bloque une fois sur deux ou s’il n’a tout simplement pas le mode d’emploi pour ouvrir la porte. Il est aussi à noter que les acteurs réalisent plusieurs tâches à la fois, ce qui complexifie davantage toute velléité de modélisation des activités. L’activité humaine est donc idiosyncrasique par essence et difficilement saisissable en dehors de la situation de laquelle elle émerge. Le travail bien fait ne peut pas être une résultante de prescriptions (soft, hard skills…).
La distinction soft skills et hard skills est donc tout à fait artificielle et entre en résonance avec cette propension à la segmentation de tout pour finir par faire fi de l’ensemble.
C’est une vision tout à fait ingénierique et gestionnaire du travail qui correspond au mythe fondateur du management. L’analyse de l’activité humaine en contexte réel, comme le précise Alain Mouchet, est à la confluence de plusieurs domaines scientifiques comme la psychologie du travail et l’ergonomie, la sociologie, l’anthropologie, la santé ou encore les sciences de l’éducation. Tant que les gestionnaires (donc les entreprises) n’intégreront pas dans leur ADN la nécessité d’une diplomatie des disciplines, ils continueront très souvent, de fonder leurs actions, à partir d’un savoir qui a toutes les qualités sauf d’être vrai.
La soft skill est une illustration de plus d’un angle mort majeur de la gestion des « ressources humaines » et du management : un collectif réduit à une collection d’individus au grand dam de l’organisation comme entité sociale dans laquelle s’exprime des stratégies d’acteurs liées aux contraintes et aux ressources (y compris ressources psychologiques et sociales) disponibles. Placé dans un environnement non capacitant, il est difficile, pour tout professionnel, de mettre en action, au bon niveau de maturité, ses qualifications et aptitudes professionnelles. Dès lors, faute d’adapter l’organisation à la sensibilité humaine, on organise l’humain, l’objectif étant de prescrire les conduites individuelles jusque dans les moindres détails. C’est ce que certains auteurs nomment la « rationalisation des subjectivités ».
Le vrai sujet, ce n’est pas tant les « soft skills » quand bien même on pourrait les isoler indépendamment du contexte mais la capacité de toute organisation à lutter contre l’entropie par la mise en place d’environnements capacitants.
Cela nécessite non pas de traiter les Hommes c’est à dire le travailleur mais de traiter le travail qui est aujourd’hui malade voire agonisant dans beaucoup d’organisations et c’est éminemment plus ardu que lister des soft skills déconnectés du réel pour répondre à une demande de réassurance. Un tel raccourci ne peut mener que vers une impasse voire pire, un eugénisme managérial qui ne dit pas son nom. Les tests d’évaluation de soft skills peuvent permettre, fictivement, d’objectiver un tri faussement scientifique des êtres humains dans l’optique d’une amélioration de la population des travailleurs d’une entreprise donnée. Ce qui implique une déresponsabilisant totale des entreprises quant à la non mise en œuvre d’environnements capacitants c’est à dire propices au développement des individus. Nonobstant la vacuité scientifique des fondements de tels travaux, ils peuvent donc de surcroit être dangereux.
L’environnement capacitant doit bien sûr rencontrer des hommes et des femmes capables de discernement, capables de juger à bon escient car comme disait Tckechov, pour agir intelligemment, l’intelligence ne suffit pas. Néanmoins, il y a toujours un rapport dialogique entre le travailleur et son environnement de travail, rapport difficilement modélisable ni réductible à des soft skills.
Je pense néanmoins que les entreprises apportent de mauvaises solutions à un vrai problème. En effet, après avoir longtemps recherché des « ressources humaines » voire des « machines humaines » lorsque les innovations étaient généralement descendantes, elles veulent désormais trouver des « êtres humains » car ces derniers s’imposent de fait dans une économie de « cerveaux d’œuvre » qui tend vers une « démocratisation » des innovations (les innovations peuvent désormais venir des clients, des partenaires…).
La forte demande de soft skills est ainsi la preuve par l’absurde que l’approche exclusive par les compétences a fini par montrer ses limites : la compétence n’est qu’une aptitude à satisfaire une tâche, elle sanctionne une capacité d’adaptation. Pour pouvoir critiquer la tâche, critiquer dans le sens premier du terme c’est à dire, être capable de faire preuve de discernement, pour pouvoir innover, bifurquer comme disait Bernard stiegler, il faut combiner plusieurs types de savoirs. Les formations actuelles privilégiant la seule employabilité donc une seule forme de savoir, la compétence, il va sans dire que tout autre type de savoir est hors de mise car jugé trop théorique. Le savoir (sapĕre en latin classique) signifiant « avoir de la saveur »: vous comprendrez qu’il est difficile de transformer la saveur en compétences ou en langage de machine.
Le véritable enjeu pour les entreprises et pour la société en général, c’est de bâtir un système éducatif, des dispositifs de formation qui permettent, même à ceux qui se dirigent vers le monde de l’entreprise ou qui y sont déjà, de s’entretenir avec un savoir séculaire accumulé au fil des générations, dans différents domaines de la connaissance (philosophie, histoire, anthropologie, poésie…).
Tous ces savoirs qui nous permettent d’ouvrir des portes sans sortir de chez soi, d’aiguiser le caractère, de penser dans le temps et dans l’espace, de réconcilier la puissance et l’esprit. Il n’y a pas encore d’autres moyens pour faire des Hommes et aucun test ne pourra en attester car comme le disait Georges Canguilhem, la raison est régulière comme un comptable et la vie est anarchiste comme un artiste. Je dirais d’ailleurs comme Merleau-Ponty que « l’impatience des âmes n’est pas un argument, on ne sert pas les âmes par l’à-peu-près et l’imposture ». Le déni de l’incertitude a, de tout temps, fait émerger des pratiques divinatoires, la magie, la sorcellerie, dont nous ne nous sommes pas encore éloignés en voulant prédire et organiser l’humain. Les promesses faites aux entreprises par certains prestataires de services « Soft skills » ne résistent même pas à une analyse logique rudimentaire, a fortiori à une confrontation avec les savoirs accumulées dans les sciences du travail.
Cette velléité de maîtrise et de certitude occulte un enjeu fondamental : dans le contexte du travail, c’est dans l’incertitude irréductible, la variabilité que se niche la créativité. Nous nous retrouvons donc à combattre ce que nous louons par ailleurs. Curieux paradoxe et confirmation d’une crise de la connaissance dans les organisations. Même s’il n’existera jamais un ordre des experts-humains (et heureusement) comme il y a un ordre des experts-comptables pour traiter et défendre l’humain aussi bien que le capital, cela ne nous empêche pas de lutter de toutes nos forces contre l’obscurantisme managérial, les pyramides de Ponzi « humaines » et autres montages humains frauduleux, car, nonobstant les problèmes éthiques, il y va de la santé des travailleurs, de la santé financière des entreprises à long terme et de la santé de la société toute entière.