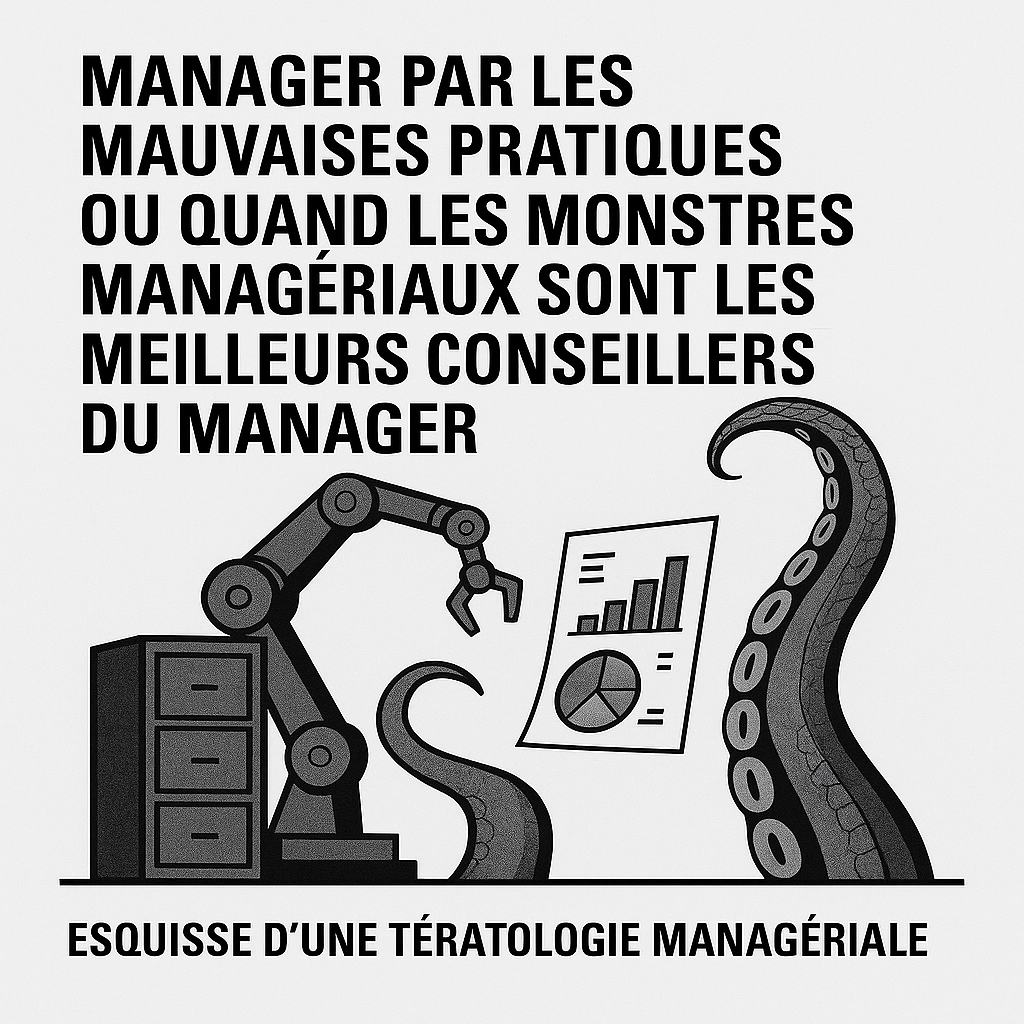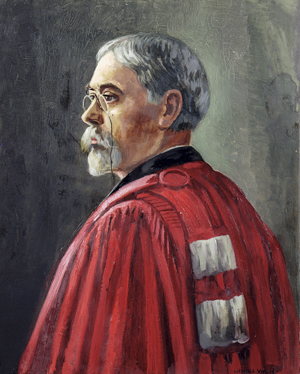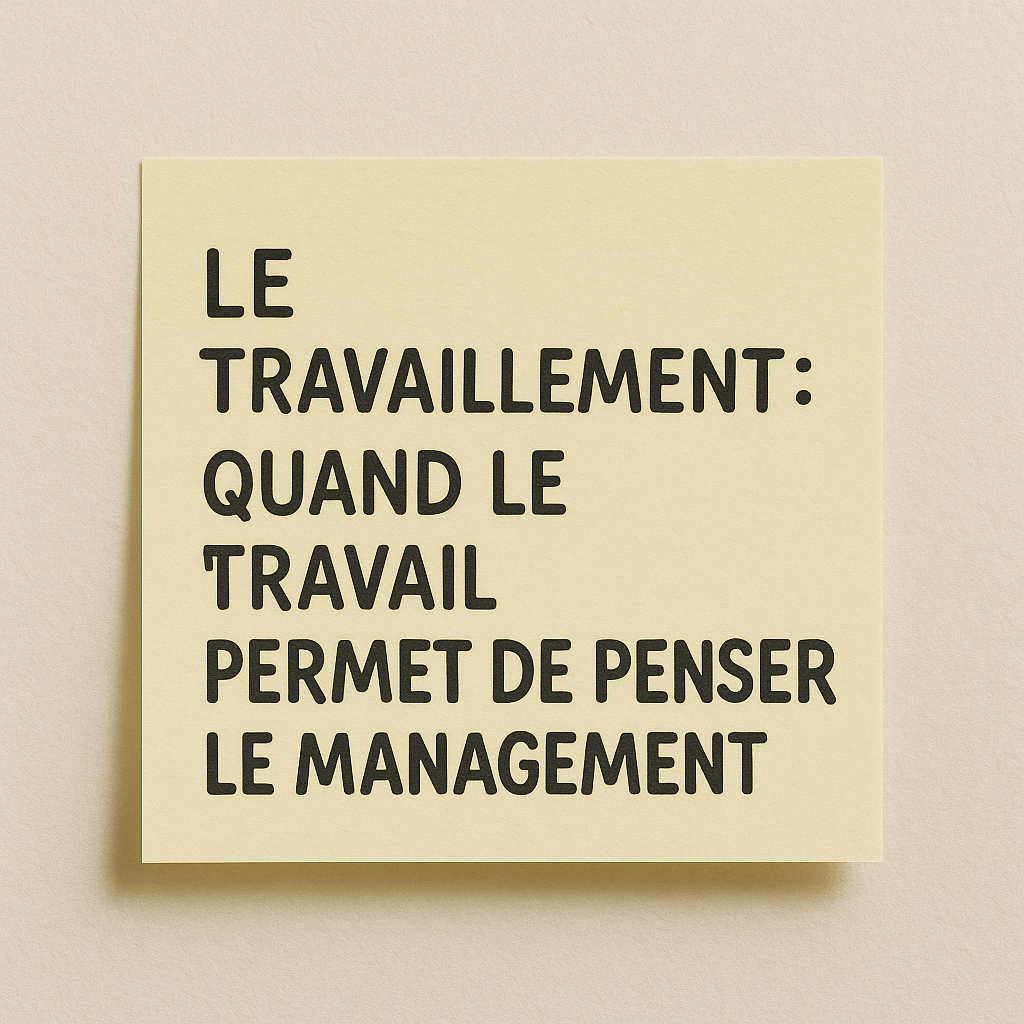Manager par les mauvaises pratiques : Esquisse d’une tératologie managériale
« Tous les arts ont produit des merveilles : l’art de gouverner n’a produit que des monstres », écrivait Saint-Just. Et si, pour comprendre ce qui fait la fécondité du management, il fallait commencer par regarder… ses monstres ?
De ce clin d’œil ironique naît une hypothèse sérieuse : donner naissance à un champ d’analyse original au sein des sciences du management que l’on pourrait nommer « tératologie managériale ». L’idée n’est pas de tourner en dérision les travers managériaux mais de comprendre ce qu’ils révèlent des dérives organisationnelles et des voies d’un management plus soutenable.
Qu’est-ce qu’un monstre managérial ?
Le mot « monstre » vient de monstrum : anomalie, déformation, ce qui sort de l’ordinaire. Mais aussi de monstrare : révéler, montrer.
Un monstre managérial est donc une déformation managériale révélatrice : il exagère une fonction, transgresse une mesure et en même temps il met en lumière les tensions et contradictions de l’organisation. En effet, comme le résume le chercheur en littérature et civilisation hispaniques médiévales, Olivier Biaggini, « le monstre n’est qu’un intermédiaire entre le doigt qui le pointe et un sens, ordonné et harmonieux, dont il n’est que le substitut allusif et abusif. Le monstre apparaît alors comme le détour et le relais de l’émergence d’un sens, d’une vérité…Non plus le monstre qui est montré, mais le monstre qui montre, ou plutôt par lequel on montre« . Le monstre est donc didactique, conclut-il.
Pourquoi une tératologie managériale ?
La tératologie existe déjà ailleurs comme science constituée :
- tératologie humaine : étude des anomalies du développement chez l’être humain (malformations, difformités congénitales) ;
- tératologie animale : observation des anomalies dans le règne animal ;
- tératologie végétale : analyse des formes atypiques dans le monde végétal (plantes aux structures déformées ou hybrides).
Dans tous les cas, la logique est la même : observer les formes atypiques pour mieux comprendre les lois générales. Les anomalies ne sont pas étudiées pour elles-mêmes, mais parce qu’elles permettent de mettre en lumière, par contraste, le fonctionnement ordinaire et les règles de structuration de la vie. Appliquée au management, la démarche est identique : les monstres managériaux ne sont pas que des curiosités ou des caricatures, mais des révélateurs qui éclairent la logique normale et pathologique des pratiques managériales.
En outre, parler de « monstre » permet d’avoir un langage commun qui aide à reconnaître des travers parfois diffus, les « mauvaises pratiques » et à engager la réflexion collective. Le monstre rend visible ce qui, autrement, resterait éclaté : comportements déviants, procédures absurdes, contradictions organisationnelles. Ainsi, théoriquement, la tératologie managériale enrichit les sciences du management en proposant un champ d’analyse original, reliant critique, clinique et symbolique. Pratiquement, elle fournit aux organisations une grille de diagnostic, un langage partagé et un outil de formation réflexif pour transformer les dérives en leviers d’apprentissage.
Monstres individuels, systémiques et culturels
Le management peut engendrer plusieurs formes de monstres :
• des monstres individuels : figures humaines déformées, caricatures incarnées ;
• des monstres systémiques : dispositifs formels absurdes, parfois vécus comme des machines qui s’emballent d’elles-mêmes ;
• des monstres culturels : normes implicites, habitudes collectives ou croyances tacites qui orientent les comportements (culte de l’urgence, valorisation du présentéisme, peur de dire non, etc.).
Ces registres ne s’opposent pas : ils se nourrissent mutuellement. Un style individuel peut engendrer un dispositif absurde ; une règle peut cristalliser une croyance culturelle ; et inversement, une culture implicite peut pousser un manager à adopter des comportements déformés.
S’agissant du registre individuel, il ne faut pas tomber dans le piège de l’essentialisation. Jusqu’à preuve du contraire, personne ne naît monstre managérial, ni ne le devient ex nihilo. On est souvent poussé à adopter des comportements monstrueux par un contexte, des jeux de pouvoir, des contraintes organisationnelles, une culture ou des dispositifs qui déforment l’action. L’objectif de la tératologie n’est donc pas de chercher des responsables ou de pointer du doigt mais de comprendre car les excès ne sont pas des fatalités individuelles mais les symptômes d’un système qui produit ses propres aberrations.
Petit bestiaire à titre d’exemple
Monstres individuels :
• Manager-Minotaure : prisonnier de son labyrinthe de procédures.
• Manager-Caméléon : change sans cesse de discours, perd la confiance.
• Manager-Golem : exécutant aveugle, il écrase le travail réel sous le prescrit.
• Manager-Vampire : capte les succès, rejette les échecs.
• Manager-Sphinx : parle par énigmes, entretient l’opacité.
• Manager-Illusionniste : nie le travail réel, confond indicateurs et activité vécue.
Monstres systémiques :
• Réunion-Hydre : à chaque point clos, deux autres surgissent.
• Processus-Frankenstein : assemblage incohérent de règles.
• Projet-Chimère : objectifs contradictoires qui s’annulent.
• KPI-Cyclope : indicateur unique qui réduit le travail à une vision borgne.
• Transformation-Sisyphe : réforme permanente qui n’aboutit jamais.
Monstres culturels :
• Culture du héros : valorisation du surengagement et du sacrifice permanent.
• Tabou de l’erreur : toute faute est bannie, bloquant l’apprentissage.
• Silence organisé : on ne dit pas ce qui dérange, par peur ou par habitude.
Une grille de lecture… pour agir
L’intérêt n’est pas seulement de sourire devant ces caricatures : il s’agit de disposer d’une grille de lecture descriptive pour mieux diagnostiquer les dérives et engager la discussion sur le travail réel.
Trois dimensions guident l’analyse :
1. Origine : d’où vient le monstre ? D’un style individuel, d’une culture collective, d’une contrainte systémique ?
2. Effets : que produit-il sur le travail réel ? Énergie gaspillée, perte de sens, fragilisation humaine…
3. Symptômes : à quoi le reconnaît-on ? Réunions interminables, indicateurs déconnectés, injonctions contradictoires, désengagement…
Croiser ces trois entrées permet non pas d’assigner des culpabilités mais de rendre visibles les déformations, de les nommer et d’en discuter collectivement.
Le monstre, entre normal et pathologique
Georges Canguilhem rappelait que le « normal » n’est pas une simple moyenne statistique, mais une capacité du vivant à instituer ses propres normes pour s’adapter, inventer, créer. À l’inverse, le « pathologique » n’est pas absence de norme, mais installation d’une norme appauvrie, plus rigide, qui réduit la marge d’invention et fragilise la vie.
Appliquée au management, cette distinction éclaire la fonction des monstres managériaux. Ils montrent que : le normal managérial n’est pas un état sans défauts mais la faculté d’une organisation à générer des règles vivantes, ajustées au travail réel et capables de se réinventer; le pathologique managérial survient lorsque ces règles deviennent rigides, se détachent du travail réel et appauvrissent l’action collective; le monstre managérial rend visible ce basculement : il incarne la limite où le normal se déforme et se retourne contre lui-même, révélant les tensions latentes d’un système.
En ce sens, le management « normal » n’est pas celui qui colle aux process standards mais celle qui donne à ses membres la possibilité de créer des normes locales adaptées aux situations de travail réelles. Un management pathologique, c’est celui qui rigidifie, qui impose des normes abstraites déconnectées du travail réel. Il réduit la puissance d’agir, empêche la création de normes locales. Les acteurs se sentent impuissants, « malades » du système. Ainsi, le normal en management n’est pas la conformité mais la créativité collective face aux situations concrètes.
Le normal managérial, c’est donc la normativité c’est à dire la capacité de créer des normes locales adaptées, efficaces et dans lesquelles, l’acteur se reconnait. Manager, c’est donc faire éclore une dialectique de la prescription : se conformer à la prescription de manière féconde, c’est à dire être capable de développer, en retour, la capacité des acteurs à prescrire eux-mêmes face aux situations réelles. Le problème n’est donc pas la prescription en soi mais la prescription qui ne crée pas un environnement adéquat pour bien prescrire au plus près du réel du travail. La fécondité managériale ne réside pas dans l’accumulation de règles mais dans la capacité des prescriptions à ouvrir un espace normatif vivant où les acteurs peuvent, à leur tour, recréer des règles ajustées aux situations. Le normal managérial, c’est donc l’expression de prescriptions fécondes.
Bon management et vitalité organisationnelle : le monstre managérial comme effet visible d’une dissonance entre valeurs, pratiques et savoirs face au réel du travail.
Dans une perspective canguilhémienne, le « bon management », n’est donc pas un modèle figé mais une capacité : celle de produire des normes vivantes, ajustées au travail réel et capables d’évoluer. Là où le management pathologique rigidifie et appauvrit, le management fécond soutient l’invention, préserve l’énergie et entretient la vitalité de l’action collective.
On pourrait ainsi dire que le monstre managérial apparaît lorsqu’il y a une discordance ou une asymétrie entre les trois registres classiques de l’action :
- Dimension axiologique (valeurs, finalités, éthique)
- Elle concerne les principes proclamés : mission, sens, justice, dignité au travail.
- La monstruosité surgit quand les valeurs affichées (ex. bien-être, inclusion) entrent en contradiction avec les pratiques réelles (ex. surcharge, précarisation).
- Dimension praxéologique (pratiques, dispositifs, modes d’action)
- Elle renvoie au « faire » : procédures, outils, pilotage, management quotidien.
- Le monstre apparaît quand les pratiques sont déconnectées soit des valeurs affichées, soit des connaissances disponibles (ex. pilotage par indicateurs qui nie la complexité du travail réel).
- Dimension épistémologique (savoir, science, connaissance du travail)
- Elle touche la capacité du management à s’ancrer dans une compréhension vérifiable du réel : ergonomie, sciences de gestion, sociologie, économie.
- La monstruosité émerge quand le management se coupe de ces savoirs ou les instrumentalise (ex. pseudo-scientificité des « méthodes miracles », jargon creux).
La monstruosité n’est donc pas qu’un excès ou une déviance ; c’est le produit d’un déphasage. Si les trois dimensions ne convergent pas vers la reconnaissance du travail réel, alors le management se déforme , il devient « monstrueux » au sens où il montre, par contraste, ce qui devrait être ajusté.
Conclusion
La tératologie managériale nous invite à changer de boussole.
Au lieu de se laisser séduire par le mirage des « bonnes pratiques », toujours réductrices parce qu’elles simplifient et figent le réel en postulant naïvement que les mêmes causes produisent les mêmes effets , il faut reconnaître que cette logique va à l’encontre même de la complexité du travail et de la vie. Les hommes, les contextes, les situations ne sont jamais identiques.
Sans compter que depuis qu’on prétend manager par les bonnes pratiques, les résultats autres que financiers à court terme, sont rarement au rendez-vous : l’engagement s’érode, les maux du travail augmentent, ce qui veut dire que nous investissons dans la décéption.
Il nous semble donc plus fécond de manager par les mauvaises pratiques c’est-à-dire d’accorder une attention particulière aux monstres managériaux. Assurément, le monstre, en grossissant les traits, en révélant les excès et les difformités, dit quelque chose de la vérité du travail. Il agit comme un conseiller paradoxal : non pas en prescrivant ce qu’il faut faire mais en montrant ce qu’il ne faut pas reproduire… et surtout ce qu’il reste à inventer. En ce sens, les monstres du management sont les meilleurs pédagogues : ils rappellent que le management n’est pas affaire de recettes toutes faites mais de création de normes vivantes, ajustées aux situations et au plus près du travail réel.
Et si le premier théoricien du management était juriste ?
Maurice Hauriou (1856–1929), théoricien majeur du droit public français, est rarement mobilisé en sciences de gestion. Pourtant, ses travaux sur l’institution offrent une conceptualisation originale et anticipatrice du management, fondée sur la conduite d’une œuvre collective dans le temps, en tension entre représentation et mouvement. Hauriou, bien avant Henri Fayol et Jean-Maurice Lahy, a formulé une pensée du management à la fois politique, incarnée et attentive au travail réel. Il s’agit d’une invitation à revisiter les fondements du management contemporain à la lumière d’un juriste institutionnaliste. Ce que Hauriou offre ainsi aux sciences de gestion et du management, c’est la possibilité d’un retournement : penser le management non à partir de l’organisation formelle ou de la performance mais à partir de ce qui fait tenir dans le temps, justesse des finalités et responsabilité des personnes. À l’heure où le management est trop souvent réduit à des procédures, des indicateurs ou des instruments de conformité, Hauriou nous rappelle qu’il est avant tout une fonction politique du lien social, une conduite située des équilibres humains et un acte instituant.
Introduction
Le management contemporain est souvent crédité à Henri Fayol (1841–1925), auteur des fonctions administratives canoniques, et à Taylor, père du management scientifique. Jean-Maurice Lahy (1872–1943), quant à lui, introduit une critique fondée sur l’analyse du travail réel. Pourtant, dès 1898, dans ses Leçons sur le mouvement social, Maurice Hauriou élabore une pensée de l’institution qui préfigure une conception du management plus riche, plus politique et plus incarnée.
2. Hauriou face à Fayol : conduire une institution, pas seulement administrer
Hauriou définit l’institution comme « Une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un pouvoir et une organisation. » (1898). Cette définition triplement structurée (idée – œuvre – durée) s’écarte d’une approche instrumentale. L’institution n’est pas un organe ni un processus mais une dynamique collective orientée par un projet. Hauriou introduit une fonction centrale, absente chez Fayol : la conduite. Ainsi, là où Fayol découpe, rationalise, planifie, Hauriou propose une régulation vivante, tenant compte des tensions, de la durée, de la symbolique, de la justice.
Chez Hauriou, le rôle du responsable est donc de conduire : maintenir l’équilibre entre les forces du mouvement (action, engagement) ou forces organiques et les forces de représentation (valeurs, normes) car « le mouvement sans représentation s’épuise ; la représentation sans mouvement se fige. ». Fayol, à l’inverse, formalise cinq fonctions (prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler) dans une logique instrumentale.
3. Hauriou face à Lahy : une attention précoce au travail réel
Jean-Maurice Lahy, dès 1913, critique le taylorisme et introduit les premières observations scientifiques sur les conditions réelles du travail humain. Il souligne que la productivité dépend du respect du rythme humain, de la subjectivité et des contraintes invisibles. Hauriou en pose déjà les fondements épistémologiques et politiques dès 1898. Jean-Maurice Lahy distingue ainsi clairement le travail prescrit, défini par les procédures et les instructions, du travail réel, tel qu’il est effectivement réalisé par les travailleurs, avec ses ajustements, ses imprévus et ses arbitrages.
Néanmoins, bien avant Lahy, Hauriou théorise un espace conflictuel entre mouvement social réel (ce qui se passe concrètement dans la société/institution (travail réel, tensions, pratiques)), la représentation du mouvement (discours, normes, valeurs…) et la conduite du mouvement (ajustement entre les deux, en situation). Pour ce dernier, le rôle du dirigeant est d’assurer la conduite régulatrice c’est-à-dire une prise en compte active du réel mouvant au sein de l’institution. Ce qu’il appelle « la conduite », c’est l’art de maintenir une certaine « température moyenne de croisière » entre ces deux pôles c’est à dire d’assurer une gestion de l’écart entre le prescrit et le réel, entre le pôle froid (représentation du mouvement) et pôle chaud (le mouvement). En effet, quand c’est trop froid, l’institution devient vide et perd prise sur le réel, quand c’est trop chaud, elle se dissout dans l’instant et perd le sens de l’œuvre.
4. Une conception instituante du management
Hauriou pense les institutions comme des systèmes d’énergie sociale. Il oppose les forces organiques (agissements concrets, travail réel…) aux forces représentatives (valeurs, normes, symboles…). Cette articulation produit de la durée et institue le sens. Il insiste sur la responsabilité et la liberté comme n’existant que dans la personne : « La responsabilité, comme la liberté, ne se trouve que dans la personne. »
Conclusion
En amont des fondations classiques du management, Maurice Hauriou développe une pensée profondément originale de la conduite des institutions. Loin d’un pilotage techniciste ou d’un commandement fonctionnel, il conçoit l’institution comme une œuvre collective en devenir qui exige un effort constant de régulation entre ce qui se fait (le mouvement) et ce qui se signifie (la représentation). En cela, il propose une vision du management comme fonction instituante, au service d’une tension féconde entre les pratiques concrètes et l’idéal qui les oriente.
Loin d’ignorer les réalités du travail, Hauriou en pressent déjà les écarts et les ajustements, en amont des travaux de Lahy sur le travail réel. Ce n’est pas un simple gestionnaire qu’il dessine, mais un conducteur responsable, dont la tâche consiste à maintenir la vitalité de l’institution, non par la seule planification, mais par l’écoute des forces sociales, la prise en compte du terrain, et la capacité à donner du sens. Le rôle du manager n’est plus celui d’un organisateur de tâches, mais d’un interprète du lien entre œuvre et action, garant de la durée et de la légitimité collective.
Redécouvrir Hauriou aujourd’hui, ce n’est pas faire œuvre d’archéologie : c’est ouvrir un horizon critique et fondateur pour réconcilier sens, responsabilité et travail réel dans les pratiques de management contemporaines.
Bibliographie :
– Hauriou, Maurice. Leçons sur le mouvement social : cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de droit de Toulouse, 1898. Paris : Félix Alcan, 1898.
– Fayol, Henri. Administration industrielle et générale : prévoyance, organisation, commandement, coordination, contrôle. Paris : Dunod, 1916.
– Lahy, Jean-Maurice. Études de psychologie du travail. Paris : Félix Alcan, 1930.
(Recueil posthume d’articles écrits entre 1913 et 1930, publié sous la direction de ses collègues après sa mort.)
Et si le travaillement, concept oublié, était la clé pour repenser le management au bon niveau ?
On peut dire sans se tromper que le mot « management » fait partie des mots vagues dont parlait Paul Valéry, qui « ont plus de valeur que de sens ; qui chantent plus qu’ils ne parlent ; qui demandent plus qu’ils ne répondent ; de ces mots qui ont fait tous les métiers, et desquels la mémoire est barbouillée de Théologie, de Métaphysique, de Morale et de Politique ; mots très bons pour la controverse, la dialectique, l’éloquence, aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu’aux fins de phrases qui déchaînent le tonnerre ».
Le problème premier du mot « management », c’est sa racine : “manager”. Autrement dit, il inscrit, presque à notre insu, une vision centrée sur la figure du manager, qu’il positionne comme acteur principal, voire indépassable de l’action collective et de la production. En effet, comme nous le rappelle Victor Klemperer « les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelques temps l’effet toxique se fait sentir ».
En l’espèce, ce glissement s’opère donc subrepticement, mais avec des effets réels : il occulte l’objet travail et le fait que tout travail véritable est une co-action, un effort partagé, une coopération vivante entre des personnes confrontées à un réel à transformer.
Le mot management empoisonne ainsi la pensée. Par sa surutilisation, par ses connotations technicistes ou gestionnaires, il constitue un écran conceptuel : il détourne le regard de l’essentiel, à savoir le travail réel. Or, c’est précisément le travail, dans sa matérialité, ses tensions, ses exigences, qui constitue la condition de possibilité d’un management digne de ce nom. Quand on oublie cela, on en vient à croire que le management produit le travail. Mais c’est l’inverse : c’est le travail qui donne sens au management, et non le management qui donne sens au travail. Un manager n’est rien d’autre qu’une personne de plus pour que le travail soit bien fait.
Face à ce vice caché du mot « management » bien implanté dans les esprits dont découle une vision héroïque et instrumentale du gouvernement des Hommes et de l’action collective rendant ainsi silencieux la réalité concrète de ce qu’est le travail, je propose de ressusciter un mot français tombé en désuétude pour exprimer, dans la dynamique de l’action collective et de la production, la centralité du travail : le travaillement.
Le terme « travaillement » est attesté en ancien français, dérivé du verbe travaillier (ancien français pour « souffrir, endurer »). Il signifiait alors souffrance ou peine. Il est par ailleurs répertorié dans le Dictionnaire du Moyen Français (DMF) avec le sens de « effort » ou « fatigue ». Au XIXe siècle, « travaillement » apparaît dans des contextes techniques, notamment en chimie. Il désigne l’ébullition du cuivre chauffé qui se purge de gaz sulfureux. Le mot est encore utilisé en Afrique francophone notamment en Côte d’Ivoire pour désigner une forme de reconnaissance sociale qui passe par l’action de jeter des billets de banque sur un artiste, un griot ou un DJ, afin de le célébrer publiquement tout en affichant symboliquement son statut, sa générosité ou sa réussite.
Dans le contexte contemporain des entreprises et des organisations en général, nous pourrions redonner au terme travaillement une pertinence conceptuelle en le définissant ainsi :
Il s’agit de faire travailler ensemble des individus et/ou des collectifs, dans le temps et dans l’espace, en réunissant les conditions nécessaires pour que le travail soit à la fois efficace, soutenable et producteur de santé. Autrement dit, il s’agit de travailler sur le travail : en mettant en œuvre les conditions adéquates à une gestion pertinente de la distance irréductible entre travail prescrit et travail réel, mais aussi à l’ajustement permanent entre coordination et coopération. Le tout doit s’inscrire dans une dynamique temporelle et spatiale, attentive aux réalités concrètes de l’activité et aux tensions qui la traversent.
Sur le plan didactique, le concept permet une lecture transversale du travail comme expérience située, transformable, dynamique et socialement construite, qui échappe aux modèles figés ou purement gestionnaires en synthétisant ainsi non seulement des savoirs dispersés entre disciplines (psychologie du travail, sociologie, ergonomie, sciences de gestion critiques, ou encore clinique du travail etc…) mais aussi des dimensions trop souvent traitées de manière séparée : l’activité réelle et ses marges de manœuvre, la subjectivité au travail, les dynamiques collectives de coopération et de conflictualité, les conditions concrètes du bien-faire, ainsi que les rapports de pouvoir implicites dans toute organisation du travail.
Sur le plan symbolique, il permet de croiser plusieurs dimensions historiques et symboliques du mot :
1. Son ancrage étymologique qui renvoie à l’exigence exercée sur une existence. Le travaillement suppose donc une prise en compte active de cette épreuve humaine.
2. Son usage technique ancien notamment en chimie au XIXe siècle pour inviter à penser le travaillement comme un processus de transformation dynamique des relations et des pratiques collectives, qui réchauffe les liens, bouleverse les perspectives mais clarifie et fortifie le faire ensemble.
3. Sa valeur symbolique contemporaine, notamment en Afrique de l’Ouest et plus particulièrement en Côte d’Ivoire, où le mot désigne une mise en scène de l’effort et de la générosité tournée vers le collectif. Le travaillement acte un geste de reconnaissance sociale et d’affirmation identitaire, qui lie l’individuel au collectif dans un espace de visibilité.
Dans cette optique, la réhabilitation du terme “travaillement” permettrait de poser autrement les fondements du management contemporain, en rupture avec les approches instrumentales ou normatives. Une telle réappropriation présente au moins trois intérêts majeurs :
1. Assumer la centralité de la gestion de l’écart entre le travail prescrit et le travail réel dans la dynamique de l’action collective et son management. Le travail n’est pas une variable d’ajustement ni un simple résultat de procédures managériales : il est le cœur vivant de toute organisation. Parler de travaillement, c’est reconnaître l’effort concret, dynamique, situé et parfois conflictuel du faire ensemble, de la coopération, de la production de sens et de performance.
2. Recentrer le management sur sa finalité : le travail bien fait et la performance soutenable. Le management ne saurait être une fin en soi. Il doit se mettre au service du travail bien fait, entendu comme une activité soutenable, efficace, et productrice de santé, tant pour les individus que pour les collectifs. Le travaillement renvoie ainsi à une dynamique d’organisation du travail qui conjugue performance, soutenabilité, reconnaissance.
3. Réorienter la formation au management sur les conditions de possibilité du travaillement. Former au management, ce n’est pas transmettre des recettes ou des outils désincarnés. C’est aider à comprendre et à créer les conditions (organisationnelles, relationnelles, symboliques, matérielles) dans le cadre d’un travaillement c’est à dire d’une action concrète, vivante et continue sur le travail. Cela suppose une culture du discernement, de l’écoute et du dialogue au prise avec le réel du travail.
En conclusion, la réhabilitation du concept de travaillement permet de rééquilibrer la relation entre le travail comme dynamique et le management comme cadre structurant.
En effet, le terme travail, tel qu’il est mobilisé dans les discours professionnels, demeure souvent silencieux sur ce qui en constitue la réalité profonde : le travail réel, avec son lot d’expériences vécues, de régulations fines, d’arbitrages éthiques et d’engagements dans la durée, autant de dimensions que seul le travaillement permet de penser de manière cohérente, en les rendant pleinement intelligibles, sans rompre avec la racine même du mot travail.
Contrairement aux idées reçues, la littérature, ça paye même pour les managers, en régime de croisière comme en période de transformation. Nous n’avons jamais eu autant besoin de littérature pour commercer véritablement avec le réel dans les organisations et ainsi réussir les transformations tant désirées. L’aveuglement technologique actuel nous fait perdre de vue l’enjeu du siècle qui n’est pas que technique (si c’était le cas, nous n’aurions pas autant de transformations qui échouent), il est surtout humain et social car comme l’avait bien vu Gaston Berger, « tout commence par la poésie, rien ne se fait sans la technique. Mais il faut que la poésie soit partout si présente que l’apprentissage des mécanismes ne tarisse pas la source vive de la création ». « Ne pas tarir la source vive de la création » pour utiliser les technologies de manière efficace et soutenable, être capable de développer la sensibilité et l’imagination des managers au service du jugement correct sont désormais les aptitudes qui feront la différence entre les professionnels et entre les organisations, qu’elles soient privées ou publiques. Nos organisations sont-elles prêtes pour ce renversement ? C’est l’objet de ma dernière vidéo sur Xerfi Canal
En entreprise, accuser quelqu’un d’être « théorique », c’est prononcer à son encontre une peine de mort sociale symbolique. Cruel paradoxe ! En effet, pour un manager, détester tout ce qui peut sembler théorique, c’est comme un médecin qui détesterait la biologie humaine. Nul doute qu’un tel médecin puisse être un piètre médecin. Nul doute également qu’un manager « théoriphobe » et/ou philistin crée plus de chaleur que de valeur, plus de méfaits que de bienfaits, pour le collectif, dans le temps long. C’est l’objet de ma dernière vidéo sur Xerfi Canal
Changement, transformation et foi du charbonnier
Une entreprise m’a récemment sollicité pour challenger les propositions techniques de grands cabinets de conseil en management sur la mise en œuvre d’un « plan de conduite du changement » international.
Je suis conscient du bashing de certains consultants comme pipoteurs devant l’éternel. À la lecture des documents, je pense que le chapeau est trop grand pour eux car tout ne leur est pas imputable. Je m’explique :
Les propositions que j’ai eu la chance de lire ne peuvent pas résister à un examen sérieux par la raison nourrie par les sciences humaines et sociales. Les cabinets y promettent de « changer les comportements par des formations », d’informer pour « ancrer dans les consciences », de créer « des moments amicaux pour developer la coopération »,… le tout auréolé de gadgets technologiques car cela fait plus sérieux.
C’est un truisme de dire qu’ils proposent ce type de démarches et d’approches car c’est ce qui se vend : c’est l’offre et la demande.
La question fondamentale est alors celle-ci : Pourquoi des gens raisonnables dans les entreprises achètent des prestations si loin du réel ?
Je rejoins l’analyse de Maurice de Montmollin pour qui le client qui s’adresse à ces consultants « plus comme à une sorte de prêtre » que comme à un homme de science auquel on demande des preuves solides.
Comme le note toujours De Montmillon, chez les entreprises clientes, « assez curieusement le cadre supérieur, souvent scientifique de formation, abandonne tout rationalisme et tout empirisme aux portes du domaine des sciences humaines. Il se laisse guider et berner par des intuitions ou des croyances qui sont plus proches de la foi du charbonnier que de celle de Thomas d’Aquin. L’ennui est qu’il se soumet ainsi sans contrôle ni conscience à des idéologies obscurantistes dont il a horreur dans sa vie professionnelle courante ».
Je vais même plus loin en paraphrasant Durkheim au sujet de l’histoire pour dire que « l’inconscient, c’est le management ». Les croyances nourrissent beaucoup d’actes manageriaux. Et il y en a des tenaces : manager, c’est résoudre des problèmes, « les hommes sont ce qu’ils sont » donc la réussite à un poste dépend du processus de sélection, « le sens se transmet par les mots » et tutti quanti.
Il est donc raisonnable de penser qu’on ne transforme pas véritablement une organisation sans affronter le réel : sans séparer « les faits des fables ». Ce qui coûte en réflexion donc en temps, en ressources et en pouvoirs.
Reste une question : les entreprises sont-elles prêtes à abandonner des croyances pour une organisation transformée ?
La croyance est confortable car elle permet d’économiser de la complexité à court terme. Ainsi, un des dirigeants d’un des cabinets cités ci-dessus, m’a glissé en aparté, qu’il est « conscient des limites structurelles de sa proposition mais que beaucoup de clients sont sourds à toute solution qui ne serait pas instrumentale ». Il a raison.
Science, compétence, art : pourquoi résumer le management à une de ces notions traduit toujours une erreur de catégorie ?
Une philosophe connue qui écrit sur l’entreprise a récemment déclaré que le management n’était pas une promotion mais une compétence. C’est d’ailleurs un avis communément admis.
Même si je comprends l’idée sous-jacente dans une telle affirmation notamment le fait que tout le monde n’est pas fait pour être manager et que le management ne s’improvise pas (je suis de cet avis), il est curieux de dire que le management n’est pas une promotion tout en la résumant à une compétence. En effet, du moment où les compétences sont censées s’acquérir par le truchement de plans de développement de compétences sur la base de « référentiels de compétences », le management peut de facto être une promotion ! La phrase en question ne satisfait donc pas le fameux principe logique de non contradiction (Aristote). Opposer dans la même phrase promotion et compétence est une auto réfutation par l’auteur de sa propre thèse.
Si manager, c’est travailler le divers (dans le sens premier du terme) c’est à dire obtenir le plus en sacrifiant le moins à partir de réalités diverses allant dans des directions opposées (temps court vs temps long, efficacité immédiate vs efficacité de long terme, confiance vs procédures, commensurabilité vs singularité, préservation de l’environnement vs rentabilité économique, utilisation efficace de la force vs respect de dignité etc…), il me semble que la racine du problème réside justement dans la croyance que le management serait une compétence et qu’on pourrait dès lors l’acquérir de manière instrumentalisée via un plan de développement de compétence ou plus ou moins facilement sur le tas, l’expérience aidant.
Je saisis donc cette occasion pour, humblement, essayer de faire quelques clarifications car nous devons prendre au sérieux cette mise en garde de Horkheimer et Adorno, il y a plus de 70 ans : « lorsque la vie publique a atteint un stade où la pensée se transforme en marchandise, la tentative de mettre à nu une telle dépravation doit refuser d’obéir aux exigences linguistiques et théoriques actuelles avant que leurs conséquences historiques rendent une telle tentative totalement impossible ».
Ainsi, le management n’est pas une compétence si par compétence nous entendons l’aptitude à satisfaire une tâche c’est à dire l’exécution d’un ensemble d’instructions pour satisfaire une classe de problèmes, ce qui n’est rien d’autre que l’expression d’une capacité d’adaptation, le nec plus ultra de la pensée algorithmique (le travail de machine). Le management par essence déborde la tâche car il doit au moins pouvoir la « critiquer » dans le sens premier du terme (avoir du discernement à son encontre) donc il ne peut pas se résumer à l’expression d’une compétence. Ce qui déborde la tâche, c’est l’imagination et la sensibilité, ingrédients essentiels pour produire des jugements corrects (Sentir, c’est produire nous dit justement Paul Valéry). La capacité à faire des jugements corrects ne s’acquiert pas sur le tas et il n’y a aucun lien de causalité entre une telle capacité et la détention d’une compétence technique.
Le management n’est pas une science si par science nous entendons « l’ensemble des recettes qui réussissent toujours » (Paul Valéry). Aucune recette managériale ne réussit partout et tout le temps malgré la réclame sur les « bonnes pratiques » dans les livres de management. Les managers ne sont donc pas des « scientifiques » du travail, c’est un truisme de le dire. Néanmoins, le management peut et doit se fonder autant que possible sur la science.
Le management n’est pas un art si par art nous entendons comme le dit Jacques Thuillier, historien de l’art et collectionneur « la création d’une forme qui se signifie elle même ». Le management ne se signifie pas lui même, au contraire, il est toujours en relation dialogique avec un environnement en perpétuel reconfiguration dans lequel il s’encastre pour faire sens. Si le management devait être un art, il serait un art de faire vivre les Hommes et les choses dans le temps et dans l’espace. Ce qui ne nous renseignerait en rien sur son contenu.
Le management n’est donc ni une science ni une compétence ni un art dans l’acception moderne du mot. Alors qu’est-ce que le management ?
Le management est une création de l’esprit qui se concrétise dans le réel du travail. C’est donc une pratique mais pas n’importe laquelle : c’est une pratique réflexive et politique (l’exigence de ne pas perdre le sens des ensembles) qui peut nécessiter des compétences, de la science, le doigté de l’artiste mais aussi et surtout de l’imagination et de la sensibilité pour penser le pire afin de l’écarter et pour cultiver le meilleur dans le temps et dans l’espace. Le manager est, dans cette optique, un artisan d’un réel toujours ancré dans le futur : un artisan du jugement correct.
C’est pourquoi, le management réduit à une compétence, ne peut être que l’apanage de préposés au management. Bien sûr, il nous faudrait plus de managers et moins de préposés au management ; mais pour se faire, il faut remettre dans jeu, le « je » qui a été mis hors jeu par la force des choses ou peut-être simplement par opportunisme : il faut plus sérieusement s’intéresser à l’Homme à qui l’on donnera la lourde tâche de manager car l’intelligence ne dépend pas de ce que nous savons mais de ce que nous sommes (Hubert Dreyfus).
La formation d’un tel Homme n’est pas chose aisée car elle ne peut pas être instrumentale c’est à dire avec des plans d’apprentissage réglés et contrôlés. En effet, comme nous l’apprend Wittgenstein dans « Recherches philosophiques », lorsqu’il s’agit de jugement, « ce qu’on apprend n’est pas une technique ; on apprend des jugements corrects. Il y a également des règles, mais elles ne forment pas un système, et seuls les gens expérimentés peuvent les appliquer correctement. A la différence des règles de calcul. Ce qui est le plus difficile ici est d’exprimer l’indétermination correctement et sans la falsifier ». Ce qui est donc en jeu, c’est moins « la formation des managers » comme nous le disons communément que la formation des citoyens dont certains d’entre eux deviendront des managers. Les universités et les écoles forment-elles toujours, d’abord des citoyens ? Nous avons plutôt l’impression que « l’employabilité » a phagocyté l’éducation et la civilité c’est à dire la formation de l’être humain et du citoyen! Ce qu’un penseur comme Bernanos avait bien vu : « dans l’ordre de la technique, un imbécile peut parvenir au plus haut grade sans cesser d’être un imbécile ».
Ainsi, il nous faut travailler sur ce que j’appelle une poétique des conditions de l’altérité, poétique dans le sens valéryen du terme (création), c’est à dire un travail sur les conditions de possibilité d’un Homme capable de se penser et de penser sa relation à tout ce qui peut lui être extérieur (les autres êtres humains, l’environnement dans lequel il vit, les objets qu’il crée et manipule). Un tel projet dépasse de loin les seuls enjeux managériaux car il s’agit d’une véritable politique de civilisation (Edgar Morin) face à l’indétermination de la vie et ses conséquences multidimensionnelles qui ne prennent personne par surprise. Kraus avait raison: « les bonnes idées sont sans valeur, ce qui compte, c’est celui qui les a ». Nous avons trop longtemps minimisé le travail indispensable sur celui qui accueille les idées et qui de fait les transforme. Aucune théorie managériale ne peut être féconde si elle ne rencontre pas un être humain dont les idéaux dépassent les instincts.
Là où règne une demande d’efficacité totale et immédiate, c’est à dire l’impératif de minimiser les coûts et de maximiser les gains hic et nunc , nul besoin de « manager », le préposé au management fera l’affaire !
L’interdiction de fait de l’imagination théorique notamment par le culte de la technique et de l’efficacité immédiate ouvrira toujours la voie à la folie politique (Horkheimer et Adorno) donc, bien sûr, à la folie managériale. Ainsi, aussi longtemps que l’école mettra à profit uniquement les disciplines qu’on peut traduire en langage de machine c’est à dire les disciplines « techniques », que l’apprentissage sera basé sur l’approche exclusive par les compétences, que la concurrence entre les élèves sera la norme, que faire du « bon business » se résumera à être efficace hic et nunc sans penser le prix humain, social et écologique à payer, le manager sera une exception et le préposé au management la règle, cet Homme disait sir Richard Levingstone qui comprend tout dans son travail, « excepté son but ultime et sa place dans l’organisation universelle ».
Prendre le changement pour la transformation : une méprise qui peut être fatale pour toute organisation !
Oui, même dans le management et la gestion des entreprises, Jules Renard a raison : « il n’y a pas de synonymes. Il n’y a que des mots nécessaires».
Ne pas faire le distinguo entre changement et transformation dans un contexte fortement marqué par des défis à relever (technologiques, sociaux, sociétaux, environnementaux…), c’est investir inexorablement dans l’échec !
C’est l’objet de ma dernière vidéo sur Xerfi Canal
Contrairement aux idées reçues, le « bon » manager ne se forme dans aucune école
Un dirigeant me demandait récemment si nos écoles et nos universités formaient de « bons » managers.
Ma réponse fut de lui dire que contrairement à ce que l’on croit, aucune école ne forme au « bon management » ! Est-ce un paradoxe ? Ma réponse est non!
En effet, la difficulté du management réside dans le fait qu’il ne se résume ni au bon sens ni à une concaténation de techniques et d’outils.
Manager, ce n’est pas juste trouver des solutions à des problèmes mais c’est très souvent trouver des problèmes pour ses solutions.
Pour ce faire, une des qualités majeures d’un manager réside dans sa capacité à faire de la bissociation c’est à dire relier, rapprocher, allier des idées à priori sans liens entre elles pour faire émerger de nouvelles idées : manager c’est créer à l’instar du poète. Le management est donc une œuvre de l’esprit qui se matérialise dans le réel du travail.
La création du manager, sauf exception, n’est bien sûr pas aussi spectaculaire que peut l’être celle du poète alors que les mécanismes qui sous-tendent toute création sont les mêmes. Le cours de poétique (création) donné par Paul Valéry au collège de France en atteste.
Manager, c’est faire œuvre d’imagination et de sensibilité dans un réel qui ne pardonne aucune erreur de la théorie. D’ailleurs, même l’action de décider peut être assise ou pas sur l’imagination : souvent, décider en faveur du chemin convenu peut être plus sûr mais moins porteur d’aventures et donc d’avenir pour l’entreprise.
Manager, c’est assurer une conjonction entre des outils, des techniques et l’implexe que Paul Valéry définit comme étant la production spontanée de la sensibilité. L’implexe ne se prescrit pas.
On peut donc apprendre les techniques managériales, l’histoire du management, l’histoire des grands managers etc. mais certainement pas comment être un « bon manager ». Au mieux, cela fait de vous, un bon préposé au management. Un tel constat est valable pour tous les métiers de création : poésie, chanson, peinture…
Les techniques de management s’apprennent à l’école mais le « bon management » est toujours situé dans l’espace et le temps et ne peut être que le fruit d’une éducation générale (techniques de management, éducation à la sensibilité et à l’imagination par la culture générale, éducation familiale et sociale qui forge la personnalité…), avec comme juge de paix le réel.
Le bon management est indissociable d’une vie de femme ou d’homme. Les managers sont les femmes et les hommes qu’ils sont.
Aucune école ou université ne forme un bon manager comme aucune école militaire ne forme un bon général. Le jugement correct ne se prescrit pas.
Maurice Gamelin pourtant sorti major de saint-Cyr, est considéré comme celui qui a conduit la France au désastre en 1940.