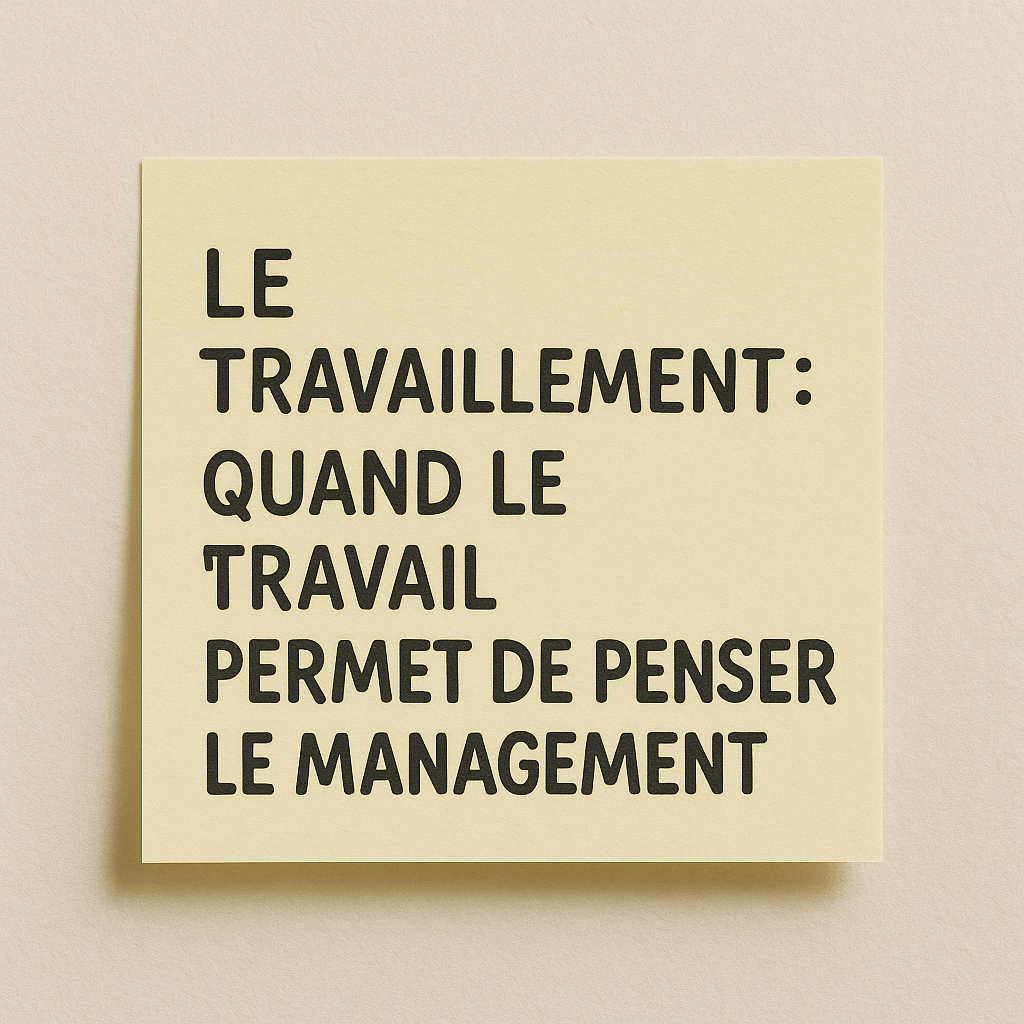On peut dire sans se tromper que le mot « management » fait partie des mots vagues dont parlait Paul Valéry, qui « ont plus de valeur que de sens ; qui chantent plus qu’ils ne parlent ; qui demandent plus qu’ils ne répondent ; de ces mots qui ont fait tous les métiers, et desquels la mémoire est barbouillée de Théologie, de Métaphysique, de Morale et de Politique ; mots très bons pour la controverse, la dialectique, l’éloquence, aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu’aux fins de phrases qui déchaînent le tonnerre ».
Le problème premier du mot « management », c’est sa racine : “manager”. Autrement dit, il inscrit, presque à notre insu, une vision centrée sur la figure du manager, qu’il positionne comme acteur principal, voire indépassable de l’action collective et de la production. En effet, comme nous le rappelle Victor Klemperer « les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelques temps l’effet toxique se fait sentir ».
En l’espèce, ce glissement s’opère donc subrepticement, mais avec des effets réels : il occulte l’objet travail et le fait que tout travail véritable est une co-action, un effort partagé, une coopération vivante entre des personnes confrontées à un réel à transformer.
Le mot management empoisonne ainsi la pensée. Par sa surutilisation, par ses connotations technicistes ou gestionnaires, il constitue un écran conceptuel : il détourne le regard de l’essentiel, à savoir le travail réel. Or, c’est précisément le travail, dans sa matérialité, ses tensions, ses exigences, qui constitue la condition de possibilité d’un management digne de ce nom. Quand on oublie cela, on en vient à croire que le management produit le travail. Mais c’est l’inverse : c’est le travail qui donne sens au management, et non le management qui donne sens au travail. Un manager n’est rien d’autre qu’une personne de plus pour que le travail soit bien fait.
Face à ce vice caché du mot « management » bien implanté dans les esprits dont découle une vision héroïque et instrumentale du gouvernement des Hommes et de l’action collective rendant ainsi silencieux la réalité concrète de ce qu’est le travail, je propose de ressusciter un mot français tombé en désuétude pour exprimer, dans la dynamique de l’action collective et de la production, la centralité du travail : le travaillement.
Le terme « travaillement » est attesté en ancien français, dérivé du verbe travaillier (ancien français pour « souffrir, endurer »). Il signifiait alors souffrance ou peine. Il est par ailleurs répertorié dans le Dictionnaire du Moyen Français (DMF) avec le sens de « effort » ou « fatigue ». Au XIXe siècle, « travaillement » apparaît dans des contextes techniques, notamment en chimie. Il désigne l’ébullition du cuivre chauffé qui se purge de gaz sulfureux. Le mot est encore utilisé en Afrique francophone notamment en Côte d’Ivoire pour désigner une forme de reconnaissance sociale qui passe par l’action de jeter des billets de banque sur un artiste, un griot ou un DJ, afin de le célébrer publiquement tout en affichant symboliquement son statut, sa générosité ou sa réussite.
Dans le contexte contemporain des entreprises et des organisations en général, nous pourrions redonner au terme travaillement une pertinence conceptuelle en le définissant ainsi :
Il s’agit de faire travailler ensemble des individus et/ou des collectifs, dans le temps et dans l’espace, en réunissant les conditions nécessaires pour que le travail soit à la fois efficace, soutenable et producteur de santé. Autrement dit, il s’agit de travailler sur le travail : en mettant en œuvre les conditions adéquates à une gestion pertinente de la distance irréductible entre travail prescrit et travail réel, mais aussi à l’ajustement permanent entre coordination et coopération. Le tout doit s’inscrire dans une dynamique temporelle et spatiale, attentive aux réalités concrètes de l’activité et aux tensions qui la traversent.
Sur le plan didactique, le concept permet une lecture transversale du travail comme expérience située, transformable, dynamique et socialement construite, qui échappe aux modèles figés ou purement gestionnaires en synthétisant ainsi non seulement des savoirs dispersés entre disciplines (psychologie du travail, sociologie, ergonomie, sciences de gestion critiques, ou encore clinique du travail etc…) mais aussi des dimensions trop souvent traitées de manière séparée : l’activité réelle et ses marges de manœuvre, la subjectivité au travail, les dynamiques collectives de coopération et de conflictualité, les conditions concrètes du bien-faire, ainsi que les rapports de pouvoir implicites dans toute organisation du travail.
Sur le plan symbolique, il permet de croiser plusieurs dimensions historiques et symboliques du mot :
1. Son ancrage étymologique qui renvoie à l’exigence exercée sur une existence. Le travaillement suppose donc une prise en compte active de cette épreuve humaine.
2. Son usage technique ancien notamment en chimie au XIXe siècle pour inviter à penser le travaillement comme un processus de transformation dynamique des relations et des pratiques collectives, qui réchauffe les liens, bouleverse les perspectives mais clarifie et fortifie le faire ensemble.
3. Sa valeur symbolique contemporaine, notamment en Afrique de l’Ouest et plus particulièrement en Côte d’Ivoire, où le mot désigne une mise en scène de l’effort et de la générosité tournée vers le collectif. Le travaillement acte un geste de reconnaissance sociale et d’affirmation identitaire, qui lie l’individuel au collectif dans un espace de visibilité.
Dans cette optique, la réhabilitation du terme “travaillement” permettrait de poser autrement les fondements du management contemporain, en rupture avec les approches instrumentales ou normatives. Une telle réappropriation présente au moins trois intérêts majeurs :
1. Assumer la centralité de la gestion de l’écart entre le travail prescrit et le travail réel dans la dynamique de l’action collective et son management. Le travail n’est pas une variable d’ajustement ni un simple résultat de procédures managériales : il est le cœur vivant de toute organisation. Parler de travaillement, c’est reconnaître l’effort concret, dynamique, situé et parfois conflictuel du faire ensemble, de la coopération, de la production de sens et de performance.
2. Recentrer le management sur sa finalité : le travail bien fait et la performance soutenable. Le management ne saurait être une fin en soi. Il doit se mettre au service du travail bien fait, entendu comme une activité soutenable, efficace, et productrice de santé, tant pour les individus que pour les collectifs. Le travaillement renvoie ainsi à une dynamique d’organisation du travail qui conjugue performance, soutenabilité, reconnaissance.
3. Réorienter la formation au management sur les conditions de possibilité du travaillement. Former au management, ce n’est pas transmettre des recettes ou des outils désincarnés. C’est aider à comprendre et à créer les conditions (organisationnelles, relationnelles, symboliques, matérielles) dans le cadre d’un travaillement c’est à dire d’une action concrète, vivante et continue sur le travail. Cela suppose une culture du discernement, de l’écoute et du dialogue au prise avec le réel du travail.
En conclusion, la réhabilitation du concept de travaillement permet de rééquilibrer la relation entre le travail comme dynamique et le management comme cadre structurant.
En effet, le terme travail, tel qu’il est mobilisé dans les discours professionnels, demeure souvent silencieux sur ce qui en constitue la réalité profonde : le travail réel, avec son lot d’expériences vécues, de régulations fines, d’arbitrages éthiques et d’engagements dans la durée, autant de dimensions que seul le travaillement permet de penser de manière cohérente, en les rendant pleinement intelligibles, sans rompre avec la racine même du mot travail.